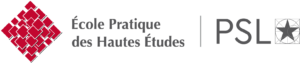Une archéologie du regard. À travers les évolutions de l’iconographie de la violence et de la brutalité

Jeudi 15 et vendredi 16 mai 2025
• 15 mai en Sorbonne, Salle des Actes
• 16 mai à la Maison de la Recherche de Sorbonne Université (rue de Serpente)
Qui est familier de l’iconographie guerrière des souverains de l’Antiquité, des palais assyriens et des temples de Ramsès II à la Colonne Trajane, ne s’étonne plus de la revendication par ces pouvoirs d’une violence légitime, entièrement assumée par le souverain et dans laquelle les victimes du bras conquérant sont réduites au statut de faire-valoir de la puissance politique qui s’affirme par la violence. Bien plus proches de nous, les photographies que les reporters font parvenir au public des conflits contemporains sont au contraire dans une grande part empreinte d’une attention spécifique aux victimes, dont la souffrance est devenue le sens prêté à la violence.
Cette évolution au long terme, dont l’évidence est trompeuse, force à s’interroger sur les mutations, non pas uniquement des motifs et de leurs significations au sein de systèmes de sens socio-culturels, mais surtout sur celle des regards, à la fois anticipés par les auteurs des œuvres et matérialisés dans les contextes d’expérience visuelle. Ce changement, dont les extrémités sont plus faciles à repérer que les étapes intermédiaires et les ruptures, se perçoit dans les différents arts visuels, tant le domaine plastique regroupant peinture, sculpture et les techniques qui en sont proches, que dans des arts plus récents tels la photographie, la bande dessinée et le cinéma.
Plusieurs systèmes d’explication ont été élaborés afin de comprendre ce changement de paradigme, qui, malgré des portées heuristiques parfois très fécondes, ne permettent d’expliquer à eux seuls l’entièreté des mécanismes à l’œuvre dans ces mutations du regard sur l’image. D’une part, les théories de René Girard ont mis en lumière les changements de conception des catégories de victime et de bourreau, à travers ce qu’il interprète comme une dénonciation des mécanismes du bouc émissaire. De l’autre, le processus de « civilisation des mœurs » étudié par Norbert Elias correspond à un abaissement des seuils de tolérance à la violence, qui intégrerait le regard porté sur les représentations. La perspective doit ainsi être élargie, de sorte à inclure les apports plus récents des sciences sociales, à la fois en termes d’interprétations renouvelées des phénomènes de violence et quant aux différences entre régimes iconographiques.
Le colloque regroupe ainsi des communications touchant à tous les médiums visuels, comprenant la peinture, la sculpture, la photographie, le cinéma et l’image scientifique. Les interventions s’intéresseront à des contextes variés, allant du Proche-Orient ancien, du christianisme antique et de l’époque classique maya aux conflits contemporains, tels la guerre du Vietnam et les printemps arabes, en passant par la peinture européenne du XVIIe siècle ou la presse du XIXe siècle.
→ Préparation des Actes en cours
Comité d’organisation
- Matthieu Hagenmüller – O&M Mondes pharaoniques
- Emma Maurel – Université de Toulouse
- Azadeh Yekdaneh – O&M