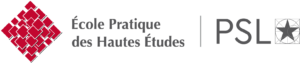Appel à communication : colloque « Zirides et le monde islamique XIe-XIIe siècle »
L’Ifrīqiya ziride et le monde islamique (Xe-XIIe siècles)
28- 29 mai 2026
Appel à contributions (date limite: 30 septembre 2025)
[english version below]
University College London, UK
Organisatrices : Corisande Fenwick (UCL), Annliese Nef (Paris
1 Panthéon-Sorbonne), Viva Sacco (UCL)
L’étude de l’Afrique du Nord médiévale connaît un véritable renouvellement. Des
travaux récents sur les périodes califale, aghlabide et fatimide précoce, ainsi que sur les
imamats ibadites, ont transformé notre compréhension de l’histoire complexe de la
région au début de la période islamique.
Les Zirides (972-1148), quant à eux, ont été la première des grandes dynasties
berbères (ici Sanhaja) à régner en Afrique du Nord, leur influence s’étendant parfois du
Maghreb al-Aqṣā à la Cyrénaïque. Pourtant, contrairement aux Almoravides et aux
Almohades, l’Ifrīqiya ziride n’a pas fait l’objet d’une attention soutenue de la part des
chercheurs depuis la synthèse de Hady Roger Idris qui a fait date (1962). Cette dernière
ne prenait toutefois pas en compte la culture matérielle. Cette absence s’explique, d’une
part, par le poids durable du (très contesté) « mythe hilalien » — et par les descriptions
imagées d’Ibn Khaldūn évoquant la destruction généralisée des établissements, de
l’agriculture et des réseaux commerciaux par les Banū Hilāl —, et, d’autre part, par une
tendance à considérer l’Afrique du Nord comme une région en retard culturellement et
dont la production artistique dériverait de celle du Caire fatimide ou de la Cordoue
omeyyade.
Toutefois, l’Ifrīqiya ziride n’était pas une périphérie. Au carrefour de la
Méditerranée et du Sahara, la région – et ses populations – ont joué un rôle central dans
les réseaux politiques, économiques, artisanaux et savants transrégionaux, dans le
monde fragmenté mais de plus en plus connecté des Xe-XIIe siècles.
S’appuyant sur le succès du colloque Aghlabids and their Neighbors, organisé à
Londres il y a dix ans, ainsi que du volume qui en a été tiré, ce colloque vise à réévaluer
de manière critique l’histoire de l’Ifrīqiya ziride et son rôle dans le monde islamique. Pour
ce faire, elle entend réunir des chercheurs de di`érents domaines (tels l’archéologie,
l’histoire, l’histoire de l’art, la numismatique, l’épigraphie, les manuscrits…) pour faire le
point sur la question. Les communications constitueront la base d’un volume sur l’état
de la recherche (Brill s’est montré intéressé par sa publication dans la série Handbook of
Oriental Studies).
Détails de la conférence:
La conférence se tiendra à Londres, à l’UCL, les 28 et 29 mai 2026. Un généreux
financement du Barakat Trust permettra de couvrir les frais de voyage des chercheurs
venant du Maghreb.
Nous invitons les personnes intéressées à envoyer des propositions de communications
(en anglais ou français). Les questions suivantes sont des suggestions et d’autres, en lien
avec le thème du colloque, peuvent être envisagées dans les propositions :
- Comment les souverains zīrides ont-ils a`irmé leur autonomie par rapport au Caire
fatimide et émergé en tant que puissance maritime ? Comment ce processus a-t-il
remodelé les dynamiques politiques régionales ? - Quelles sont les nouvelles tendances visibles dans l’architecture monumentale et
l’urbanisme d’époque ziride (par exemple dans les villes palatines d’Achir, Sabra al-
Mansūriyya et Mahdiya). Comment reflètent-elles les évolutions du mécénat et de
l’autorité politique ? - Quelles étaient la nature et l’étendue des interactions – politiques, économiques,
socioculturelles – entre l’Ifrīqiya zīride et les royaumes omeyyades et taïfas d’al-Andalus,
les Kalbides de Sicile et les autres acteurs régionaux ? Et avec des entités politiques plus
éloignées ? - Que révèle l’archéologie sur le peuplement, le réseau urbain, les productions et les
techniques, l’agriculture et la vie quotidienne dans l’Ifrīqiya ziride ? Les découvertes
récentes remettent-elles en question, ou au contraire confirment-elles, les
interprétations anciennes qui voient dans le XIe siècle une période de déclin ? - Dans quelle mesure l’Ifrīqiya était-elle intégrée à l’économie méditerranéenne fatimide
et dans quelle mesure était-elle liée aux économies de la Sicile et de l’Égypte, comme le
suggèrent les documents de la Geniza ? - Quel rôle les réseaux commerciaux trans-sahariens ont-ils joué dans l’économie de
l’Ifrīqiya ziride ? - Quelles sont les innovations technologiques et artistiques dans la culture matérielle et
l’artisanat (céramique, verre, travail du métal, sculpture sur pierre, travail du bois) ? - Que révèle l’étude des manuscrits de Kairouan en termes d’évolutions de la production
manuscrite, des pratiques d’écriture, des réseaux savants et de la pensée juridique
malikite ? - Au-delà du « mythe hilalien » contesté, quel rôle le pastoralisme et les populations
nomades ont-ils joué à cette époque ?
Date limite de soumission
Les propositions de communication doivent être envoyées à Corisande Fenwick
(c.fenwick@ucl.ac.uk) ou Annliese Nef (Annliese.Nef@univ-paris1.fr) le 30
septembre 2025 au plus tard. Elles comprendront :
- Le titre, le ou les auteur(s) et affiliation(s) institutionnelle(s)
- Un résumé (250 mots maximum) en anglais ou en français
- Les auteurs seront informés de l’acceptation de leur contribution au plus tard fin
octobre 2025.
_________________________________________
Zīrid Ifrīqiya and the Islamic world in the 10th-12th centuries
28th- 29th May 2026
Call for Papers (deadline 30th September 2025)
University College London, UK
Organisers: Corisande Fenwick (UCL), Annliese Nef (Paris
1 Panthéon-Sorbonne), Viva Sacco (UCL)
The study of medieval North Africa is experiencing a renaissance. Recent scholarship on
the caliphal, Aghlabid and early Fatimid periods as well as the Ibadi imamates has
transformed our understanding of North Africa’s complex history in the early Islamic
period. The Zīrids (972-1148), a Berber Sanhaja dynasty, were the first of the great Berber
dynasties to rule North Africa with their reach extending from the Maghrib al-Aqṣā to
Cyrenaica at times. Yet unlike the Almoravids and Almohads, Zīrid Ifrīqiya has not
received sustained scholarly attention since Hady Roger Idris’s (1962) landmark history
which notably overlooked material culture. This neglect is explained, in part, by the
enduring power of the (much contested) ‘Hilali myth’ and Ibn Khaldun’s vivid descriptions
of widespread destruction of settlements, agriculture and trade networks by the Banū
Hilāl tribes, and, in part, by a tendency to view North Africa as a cultural backwater whose
artistic production was derivative of Fatimid Cairo or Umayyad Cordoba. However, Zīrid
Ifrīqiya was no periphery. At the crossroads of the Mediterranean and the Sahara, the
region – and its peoples – played a central role in transregional political, economic, craft
and scholarly networks in the fragmented but increasingly connected world of the 10th-
12th centuries.
Building on the success of the Aghlabids and their Neighbors conference held in London
a decade ago and of the volume published in its aftermath, this conference aims to
critically re-evaluate Zīrid Ifrīqiya and its role in the Islamic world and to bring together
scholars in di`erent fields (e.g. archaeology, history, art history, numismatics, epigraphy,
manuscripts) who seldom have the opportunity to discuss these issues with each other.
Papers from the conference will form the base of a state-of-field volume (Brill has
expressed interest in publishing the volume in its Handbook of Oriental Studies series).
Conference details
The conference will be held in London at UCL on 28th-29th May 2026. Generous funding
from the Barakat Trust will allow us to cover the travel costs of scholars from North Africa.
We invite paper proposals for communications (English/ French) on the following
themes, including but not restricted to:
- How did the Zīrid rulers assert autonomy from Fatimid Cairo and emerge as a significant
political and maritime power? How did this process reshape regional political dynamics? - What new trends are visible in monumental architecture and urbanism (e.g. the palacecities
of Achir, Sabra al-Mansūriyya, Mahdiya). How do they reflect shifts in patronage and
sovereignty? - What were the nature and extent of Zīrid Ifrīqiya’s interactions – political, economic,
socio-cultural – with the Umayyads and Taifa kingdoms of al-Andalus, the Kalbids of
Sicily and other regional players? With more distant political entities? - What does archaeology reveal of settlement patterns, urban networks, production and
technology, agriculture and daily life in this period? Do recent findings challenge, or
support, long-held assumptions of 11th-century abandonment and decline? - How integrated was Ifrīqiya into Fatimid Mediterranean economy and how related was
it to Sicily’s and Egypt’s economies, as is so vividly suggested in the Geniza documents? - What role did Saharan trade networks play in shaping Zirid Ifrīqiya’s economy?
- What new technological and artistic innovations are visible in material culture and
craftsmanship (e.g. ceramics, lustrewares, glass, brasses, stone-carving, woodwork)? - What do the Kairouan manuscripts reveal about shifts in manuscript production, writing
practices, scholarly networks, and the evolution of Mālikī legal thought? - Moving beyond the contested ‘Hilali myth’, what role did pastoralism and mobile
peoples play in this period?
Deadline for submissions
Paper proposals for the conference should be sent to Corisande Fenwick
(c.fenwick@ucl.ac.uk) or Annliese Nef (Annliese.Nef@univ-paris1.fr ) by 30th September
2025
- Title, author(s) and institutional afiliation(s)
- Abstract (max 250 words) in English or French
- Authors will be notified of acceptance of their contribution no later than end
October 2025.