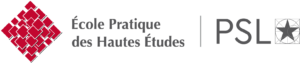NORMMED : Pluralisme normatif et construction de normes partagées en Méditerranée au Moyen Âge (XIe-XVe siècle)
L’objectif de ce projet de recherche est de comprendre comment s’est progressivement construit à la fin du Moyen Âge le cadre normatif des relations entre chrétiens, juifs et musulmans en Méditerranée, aussi bien dans leur dimension conflictuelle qu’à travers les modalités des échanges politiques et économiques.
Or depuis la disparition de l’empire romain il n’existe plus de loi unifiée ni de pouvoir pour l’appliquer. Si le pluralisme normatif est un trait commun à toutes les sociétés prémodernes, il est particulièrement marqué dans un espace comme la Méditerranée qui se distingue par la très grande diversité de normes qui peuvent apparaître, à première vue, inconciliables. Les canonistes chrétiens, comme les fuqahâ’ musulmans ou les rabbins juifs pensent ces relations à travers des règles dont les logiques reposent sur des frontières et des hiérarchies entre croyants et infidèles. Les Etats produisent leurs propres corpus juridiques et se dotent de moyens judiciaires et coercitifs pour les faire appliquer. En plus de cette pluralité des instances productrices ce droit, il faut également tenir compte de la grande diversité et de l’évolution de ces normes, en fonction du contexte.
Dans ce contexte, quelles règles suivre pour la conduite de la guerre, mais aussi la diplomatie et la paix ? Comment établir la validité des contrats entre juifs, chrétiens et musulmans ? quel droit maritime appliquer dans des espaces sur lesquels aucune souveraineté n’est reconnue ? Quelles instances judiciaires sont-elles habilitées à arbitrer entre des acteurs relevant de souverainetés et de droits différents ? Il est manifeste que les médiévaux s’accommodaient de cette diversité des normes, mais aussi des pouvoirs politiques et des instances judiciaires, qui n’ont empêché ni de faire la paix ni de développer des échanges. Le projet NORMMED vise à comprendre, au-delà de ce constat d’évidence, comment concrètement se sont articulées ces différentes règles, et quelle hiérarchie des normes s’est construite ?
Cette question du pluralisme normatif et judiciaire au Moyen Âge a déjà été explorée, dans des espaces relativement homogènes, notamment au sein du monde islamique. Des travaux sur la Méditerranée à l’époque moderne ont pu aborder le problème spécifique qui résulte de la présence de pouvoirs chrétiens et musulmans, mais sans en interroger la genèse. Or c’est bien à l’époque médiévale, et notamment à partir du XIe siècle lorsque les accords diplomatiques se multiplient, que s’expérimentent puis se fixent un certain nombre de principes régulant les relations entre chrétiens, juifs et musulmans, qui apparaissent déjà aboutis à l’époque moderne. La fin de l’unité politique qui avait marqué l’empire romain fait en effet de la Méditerranée une mer sans souveraineté unique reconnue. Il en résulte non seulement un état de conflit latent, entrecoupé de trêves bilatérales, mais aussi une situation de pluralisme juridique qui pose le problème de l’élaboration de règles partagées. Or si la législation d’inspiration religieuse, comme le discours des textes, continuent de raisonner en termes d’opposition irréductible entre croyants et non-croyants, les traités de paix bilatéraux entre puissances montrent une approche différente, dans laquelle la distinction religieuse est absente. La correspondance diplomatique, mais aussi les actes de la pratique commerciale, montrent par ailleurs des accommodements, au quotidien, avec les règles édictées par l’Eglise ou les fuqahâ’. Tout en cherchant à rester en conformité avec ces dernières, mais parfois aussi en s’en écartant partiellement et plus ou moins ouvertement, les Etats cherchent à établir des règles communes qui définissent les limites de la violence légale et leurs devoirs de protection des gens de mer ou des populations littorales, mais établissent aussi des normes pour les relations diplomatiques ou le statut des étrangers.
C’est cette genèse médiévale de la production de normes partagées que le projet NORMMED cherche à comprendre, à partir de l’analyse de la production de normes écrites, mais aussi des pratiques qui font apparaître des coutumes partagées et surtout une hiérarchie des normes qui parfois entre en contradiction avec le discours de différentiation religieuse. Son étude impose de s’intéresser à tous les domaines des échanges interculturels : non seulement aux relations politiques et diplomatiques, mais aussi aux pratiques commerciales, aux règles de séjour des étrangers, au droit maritime, etc. Elle exige également de croiser, autant que les sources le permettent, les points de vue des acteurs de l’ensemble de la Méditerranée grecque, latine et islamique, qu’ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, et donc de faire collaborer des spécialistes de ces différents espaces. C’est la condition d’une histoire à parts égales qui remet les acteurs du monde islamique, mais aussi grec, au cœur de cette réflexion partagée.
Réalisations
Séminaire Méditerranée médiévale
coord. : Dominique Valérian, Damien Coulon, Ingrid Houssaye Michienzi, Thomas Tanase
- 30 septembre 2024 Dominique Valérian (Université Paris 1, UMR 8167 Orient & Méditerranée, IUF) Les normes de la paix, de la diplomatie et de la guerre – Introduction.
- 2 décembre 2024 Guillaume Calafat (Université Paris 1, IHMC) Jalons pour l’étude des traités de paix et de commerce européens avec Tunis et Alger (17e-18e siècles)
- 16 décembre 2024 Dominique Valérian, Mettre fin à la violence sur mer: la régulation de la piraterie dans les négociations et traités de paix.
- 13 janvier 2025 Sylvie Denoix (CNRS – UMR 8167 Orient & Méditerranée),
- De l’importance de l’étude du lexique pour comprendre les référents historiques : à propos du vocabulaire de la paix en Islam médiéval
- 3 mars 2025 Damien Coulon (Université de Strasbourg), Les relations diplomatiques entre rois d’Aragon et sultans mamluks, mi-XIIIe-mi-XIVe siècle. Une stratégie de contre-croisade ?
- 24 mars 2025 Daniel König (Université de Constance), Dhimma. D’un prototype préislamique à une norme transméditerranéenne temporaire
- 26 mai 2025 Bogdan Smarandache (Université de Liège), Les accords franco-musulmans entre l’époque ayyūbide et le début du règne des sultans baḥrites (569–689/1174–1290) : un répertoire partagé des concepts légaux.
- 2 juin 2025 Stéphane Péquignot (EPHE), La table des négociations. Un objet d’histoire?
journée d’étude Les normes de la paix, de la diplomatie et de la guerre
Vendredi 20 juin 2025 – 9h-18h, Campus Condorcet, centre de colloque
- Dominique Valérian (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Introduction
- Pierrick Gerval (Nantes Université) : Les normes de la guerre et leurs transgressions dans le monde byzantin (VIIe-XIIIe siècles)
- Roser Salicru (CSIC, Barcelone) : Les relations diplomatiques entre la Couronne d’Aragon et le monde islamique
- Isabelle Lazzarini (Università degli Studi di Torno) : Un pluralisme inter-italien : la multiplicité des traités dans l’Italie du bas Moyen Âge
- Mohamed Ouerfelli (Aix-Marseille Université) : Les négociations diplomatiques en temps de crise : Venise et les Hafsides à la fin du XIVe siècle
- Thomas Tanase (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) : Les latins face à l’universalisme mongol
- Dante Fedele (Université de Lille) : Le problème des alliances entre chrétiens et « infidèles » dans le conflit entre l’Ordre teutonique et la Pologne-Lituanie au début du XVe siècle
- Stéphane Péquignot (EPHE) : Conclusions