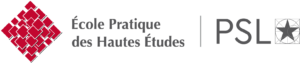Histoire et archéologie de l’Islam médiéval. Séminaire de l’équipe Islam médiéval
Le séminaire repose sur une alternance entre des séances plénières et des ateliers
Programme des séances 2025-2026
- 24 septembre 2025 (IRBIMMA) :
Introduction au séminaire
- 1er octobre 2025 (IRBIMMA) Orient :
Tamar Kvartskhava (Sorbonne Université), ‘Quiconque transporte un livre d’un pays à l’autre recevra trois récompenses’ — Interroger la mobilité des objets écrits dans les premiers siècles de l’Islam à travers la documentation papyrologique
- 8 octobre 2025 (Colegio) Occident :
Clément Salah (University of Oxford), Scribe et savant : la pratique intellectuelle d’Abū l-‘Arab (m. 333/945) et la culture manuscrite à Kairouan (IXe-Xe siècle)
- 15 octobre 2025 (Salle Picard) Actualités :
Abdullatif Zaki Abu Hashim (Iremam, Aix-en-Provence) The Cultural Heritage of Gaza: Wealth, Destruction, and Preservation .
Attention, cette séance se tiendra exceptionnellement salle Picard (Sorbonne, 3e étage, en face de l’ascenseur).
- 22 octobre 2025 (Colegio) Occident :
Ahmed El Bahi (Université de Kairouan), La réécriture de l’Histoire de l’Ifrīqiya médiévale : l’apport de sources découvertes récemment.
- 5 novembre 2025 (IRBIMMA) Orient :
Adrien de Jarmy (Université de Strasbourg), Comment naît une tradition ? Dire et écrire le hadith aux premiers siècles de l’islam.
- 12 novembre 2025 (IRBIMMA) Actualités :
Jocelyne Dakhlia (Ehess), « Harems et Sultans. Genre et despotisme au Maroc et ailleurs, XIVe-XXe siècle », à propos d’un livre récent.
- 19 novembre 2025 (IRBIMMA) Ateliers :
Lecture de textes arabes médiévaux (Mathilde Boudier, Mathieu Tillier) / Sciences sociales (Annliese Nef, Vanessa Van Renterghem)
- 26 novembre 2025 (IRBIMMA) Orient :
Martina Ambu (Université libre de Bruxelles) et Perrine Pilette (Cnrs, UMR8167), Documents bilingues guèze-arabe dans les manuscrits éthiopiens d’Égypte (XIV-XVe s.)
- 3 décembre 2025 (IRBIMMA) Ateliers :
Lecture de textes arabes médiévaux (Mathilde Boudier, Mathieu Tillier) / Sciences sociales (Annliese Nef, Vanessa Van Renterghem)
- 10 décembre 2025 (Colegio) Occident :
Amandine Lefol (Inalco), Des chroniques au miroir : la mise par écrit des vers du souverain Abū Ḥammū II (m. 791/1389)
- 17 décembre 2025 (Colegio) Ateliers :
Lecture de textes arabes médiévaux (Mathilde Boudier, Mathieu Tillier) / Sciences sociales (Annliese Nef, Vanessa Van Renterghem)
- 28 janvier 2026 (IRBIMMA) Orient :
Arezou Azad (Inalco), Persian as a referential language in the medieval Islamicate lands.
- 4 février 2026 (Colegio) Occident :
Mehdi Ghouirgate (Université Bordeaux-Montaigne), Entre langues berbères et arabes : l’histoire du Maghreb au prisme du rapport oralité et écriture
- 11 février 2026 (IRBIMMA) Actualités :
Frédéric Imbert (Aix-Marseille Université), L’Islam des pierres. L’épigraphie aux sources de l’Islam.
- 18 février 2026 (IRBIMMA) Orient :
Inès Weinrich (Friedrich-Schiller-Universität Jena), How to capture the ephemeral? The study of sound in Muslim history
- 25 février 2026 (Colegio) Occident :
Lameen Souag (CNRS, UMR 7107 LACITO), L’influence de l’arabe en berbère au Moyen Âge.
- 11 mars 2026 (IRBIMMA) Ateliers :
Lecture de textes arabes médiévaux (S. Garnier) / Cartographie historique (Hélène Renel)
- 18 mars 2026 (IRBIMMA) Orient :
Jakub Sypiański (Università Ca’ Foscari Venezia), Le grec byzantin dans le mouvement de traduction abbasside.
- 25 mars 2026 (IRBIMMA) Ateliers :
Lecture de textes arabes médiévaux (S. Garnier) / Cartographie historique (Hélène Renel)
- 1er avril 2026 (IRBIMMA) Actualités :
Hélène Renel (Cnrs, UMR8167), Les réseaux commerciaux dans l’océan Indien entre le XIIIe et le XVIe siècle au prisme de la culture matérielle de Qalhât (Oman)
- 8 avril 2026 (Colegio) Occident :
Linda Jones (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona), A Sound-Based Approach to the Study of Medieval Islamic Preaching Traditions
- 15 avril 2026 (IRBIMMA) Ateliers :
Lecture de textes arabes médiévaux (S. Garnier) / Cartographie historique (Hélène Renel)
- 6 mai 2026 (IRBIMMA) Actualités :
Virginia Grossi (Université de Fribourg, projet FNS Holy Networks), Entre masjid et ḥaram : les portiques mamelouks de l’Esplanade des Mosquées de Jérusalem (1261-1516) au prisme de l’archéologie du bâti
- 13 mai 2026 (IRBIMMA) : Conclusion commune
Présentation
Séances plénières :
A/ Thématique commune: Dire, écrire, transmettre. Oral et écrit dans le monde islamique médiéval
La question de la transmission du savoir en Islam est au cœur des controverses historiographiques qui n’ont cessé de diviser les historiens depuis près de cinquante ans. Aux plus critiques, pour qui l’épopée de la prédication muhammadienne et des conquêtes relève de la légende brodée au fil d’une transmission orale, d’autres historiens opposent le recours ancien à l’écrit dans la transmission des savoirs islamiques, et par conséquent la préservation d’une trame narrative historique. Les écrits musulmans mettent eux-mêmes l’accent sur la transmission orale de maître à disciple, que les isnād-s étaient supposés consigner. À cette image s’oppose celle de l’Islam comme « civilisation de l’écrit », riche de ses bibliothèques et de ses libraires-copistes grâce à l’adoption précoce du papier. Ce séminaire a pour ambition d’explorer le rapport entre oralité et écriture dans le monde islamique médiéval, et ses implications pour l’histoire religieuse, sociale, économique et politique.
Il s’articulera en 2025-2026 autour de trois thèmes principaux.
1. Rapport oralité/écrit dans la transmission
Le premier axe soulève la question de la relation entre l’oral et l’écrit dans les pratiques de transmission, dans le sillage de travaux comme ceux de Gregor Schoeler pour les débuts de l’Islam. Transmission dans l’enseignement : quelle était la place du texte écrit, de la lecture, de l’audition, de la récitation dans l’enseignement du Coran, des différentes branches du savoir religieux et des sciences ? Que nous en disent l’iconographie des pratiques d’enseignement et les notes portées sur les manuscrits ? Transmission des œuvres littéraires : comment s’articulaient dictée, copie, et mémorisation, tant en matière de poésie que de textes narratifs savants ou relevant des « littératures populaires » ?
2. Registres de langues et plurilinguisme.
Le deuxième axe permet d’aborder la diversité des langues d’expression et des systèmes d’écriture dans le monde islamique médiéval, mais aussi des registres au sein d’une même langue. Dans quelle mesure des traces du langage parlé subsistent-elles dans les textes écrits ? Que reflétait le choix d’écrire en « moyen arabe » ? Comment la langue arabe, « langue référentielle » du monde islamique médiéval (Benoît Grévin), coexistait-elle avec d’autres langues ? Quelles fonctions remplissaient les traductions et leurs auteurs (interprètes ou traducteurs) ? La variété des situations de plurilinguisme sera explorée à travers des communications allant des débuts de l’Islam, dans les anciennes provinces byzantines hellénisées, jusqu’aux Mamelouks turcs et circassiens.
3. Histoire sonore
Le troisième axe s’inscrit dans le récent développement des recherches sur l’histoire des sens. Comment faire l’histoire de ce qui se disait et s’entendait ? Aux témoignages sur le paysage sonore, on peut ajouter les traces écrites de pratiques essentiellement orales (comme les invocations religieuses inscrites sous forme de graffiti ou la littérature dévotionnelle). La question du support écrit auquel recouraient éventuellement les locuteurs pour leurs pratiques orales se pose aussi dans le domaine de la poésie et de la musique, ainsi que de la prédication.
B/ Actualités de la recherche en sciences humaines et sociales dans les mondes islamiques à l’époque médiévale
De la numismatique et la céramologie à la linguistique, en passant par l’étude de sources historiques, ce séminaire rend compte des nouvelles recherches ou des parutions récentes dans différentes disciplines des SHS dans le champ de l’Islam médiéval.
Les ateliers au choix
Semestre 1
- Sciences sociales : Ce que le genre fait au harem
Responsables : Annliese Nef et Vanessa Van Renterghem
On abordera les questions liées au genre dans un contexte islamique à travers la déconstruction de la conception orientaliste du harem qui a fait couler beaucoup d’encre.
Pour ce faire, nous discuterons ensemble de différents articles et chapitres d’ouvrage parmi lesquels ceux de Nadia El Cheikh ou le très récent Harems et sultans de Jocelyne Dakhlia.
- Lecture de textes arabes
Responsables : Mathilde Boudier et Mathieu Tillier
Lecture de textes arabes relatifs à la Palestine médiévale, tant documentaires que littéraires. Nous étudierons une série de documents sur papyrus découverts à Nessana et à Khirbet el-Mird, ainsi que des récits relatifs aux lieux saints à Jérusalem tirés des Annales (K. Naẓm al-jawhar) de Saʿīd ibn Baṭrīq, auteur arabe chrétien devenu patriarche melkite d’Alexandrie sous le nom d’Eutychios (933-940).
Semestre 2
- Lecture de textes arabes médiévaux
Responsable : Sébastien Garnier
Que faire de quelques feuillets d’une histoire locale des marges maghrébines ? Que penser d’une poignée d’autres traitant d’une révolte ? Que dire de documents authentiques pouvant les éclairer ? Ces légers hasards nous amènent à manipuler dans le détail des objets insolites non identifiés : déchiffrer, éditer et traduire.
Des matériaux seront adressés aux participants à la fin du S1 afin de préparer les trois séances prévues.
- Pratique de la cartographie historique en relation avec les sujets de mémoire des étudiant.es
Responsables : Sylvie Denoix, Hélène Renel
Il s’agit dans cet atelier d’apprendre à réaliser les cartes en rapport avec les mémoires (masters ou thèses). Dans la première séance, on présentera de manière théorique ce qu’est une carte historique et les prérequis pour en fabriquer, et l’on verra avec les étudiant.es quelle(s) carte(s) chacun.e pourra réaliser. Dans les deux séances suivantes, une initiation aux logiciels de cartographie sera proposée, ainsi qu’une aide à la production des cartes, accompagnant les différents mémoires.