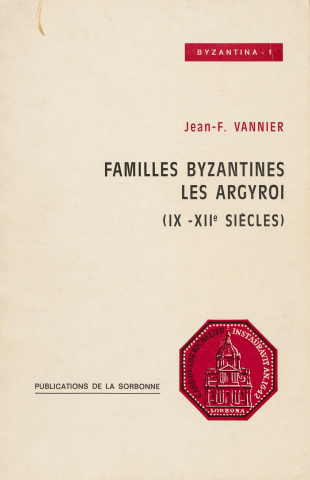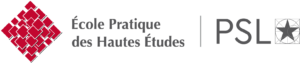Byzantina Sorbonensia
Byzance, un monde replié dans la splendeur de ses palais et de ses églises, peu accueillant et menant une économie de subsistance : rien de plus faux que ces lieux communs hérités des Lumières, ni de plus éloigné de ce que les travaux récents mettent en évidence. Le monde byzantin reste encore à découvrir. C’est ce que propose cette collection de l’Institut de recherches sur Byzance, l’Islam et la Méditerranée au Moyen Âge (IRBIMMA), de l’UFR d’histoire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en publiant les résultats de recherches scientifiques récentes, individuelles et collectives, sur le monde byzantin dans divers domaines : histoire sociale, économique, politique, religieuse, géographie, etc. Tous ces travaux témoignent des évolutions qui ont permis à Byzance de garder, de l’Antiquité au Moyen Âge, une place originale dans le monde méditerranéen médiéval.
Site des Éditions de la Sorbonne
Publications de la Sorbonne
212, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Téléphone : 01 43 25 80 15
Fax : 01 43 54 03 24
Commander les volumes sur le Comptoir des presses d’universités
-
Volume de Collection
Histoires chrétiennes en images : espace, temps et structure de la narration
Byzance et Moyen Âge occidental
Numéro : 33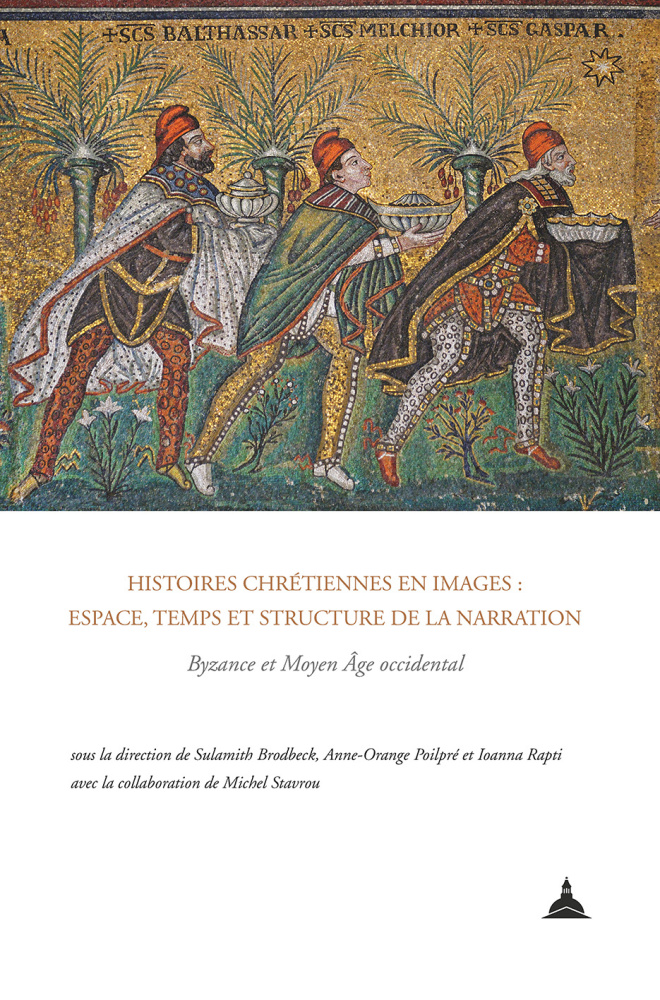
-
Volume de Collection
De très savants pasteurs
conceptions et pratiques de l’autorité des évêques dans la société byzantine dans la société byzantine des XIe-XIIe siècles
Numéro : 32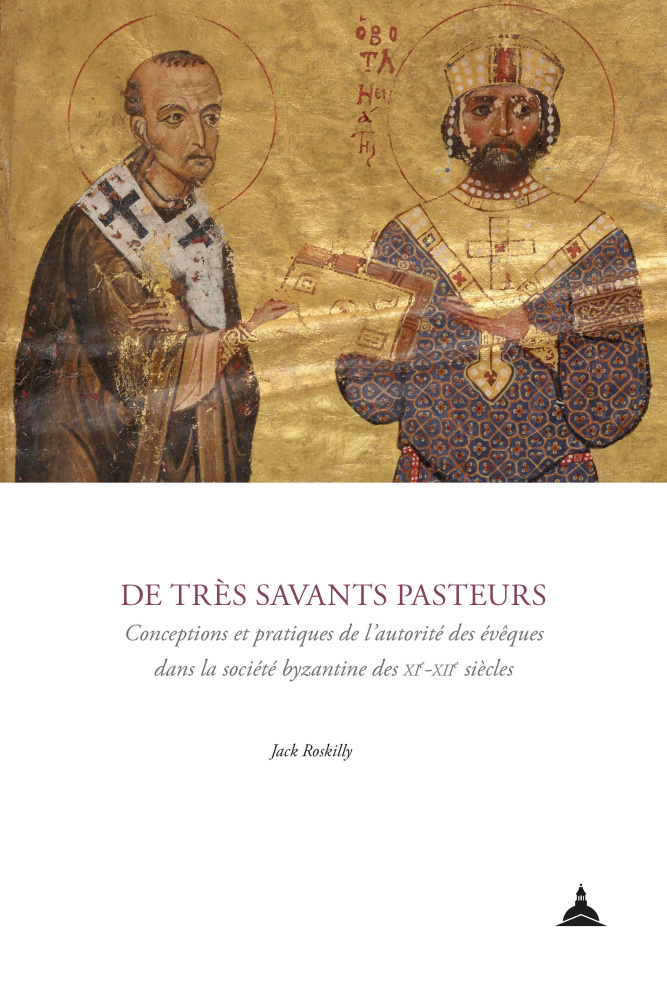
-
Volume de Collection
Les nouveaux martyrs à Byzance
I, Vie et Passion de Bacchos le Jeune par Étienne le Diacre ; II, Études sur les nouveaux martyrs
Numéro : 31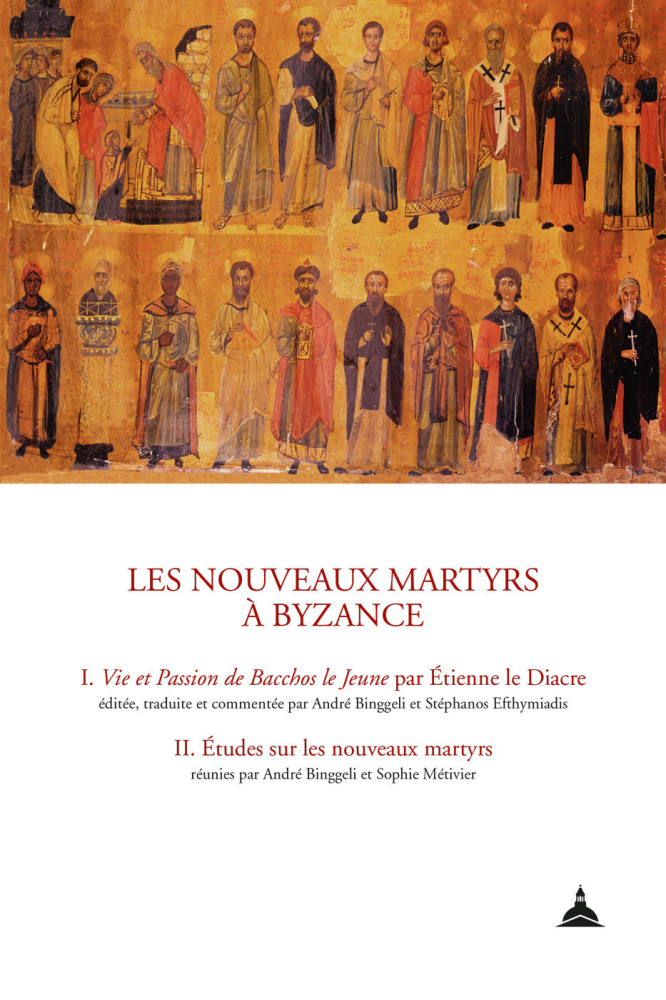
-
Volume de Collection
Visibilité et présence de l’image dans l’espace ecclésial
Byzance et Moyen Âge occidental
Numéro : 30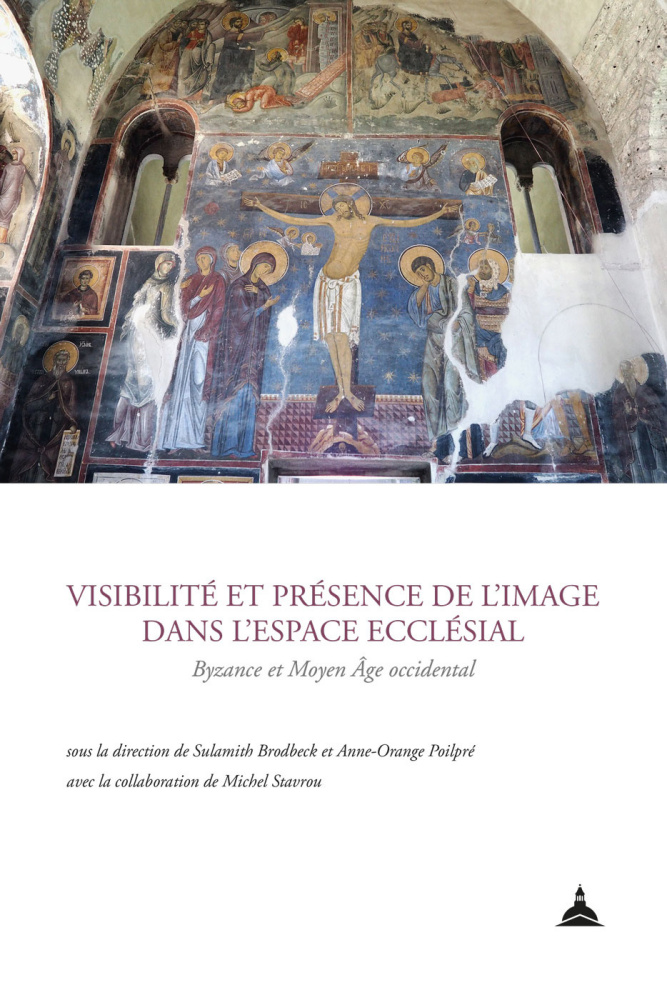
-
Volume de Collection
Le saint, le moine et le paysan
mélanges d'histoire byzantine offerts à Michel Kaplan
Numéro : 29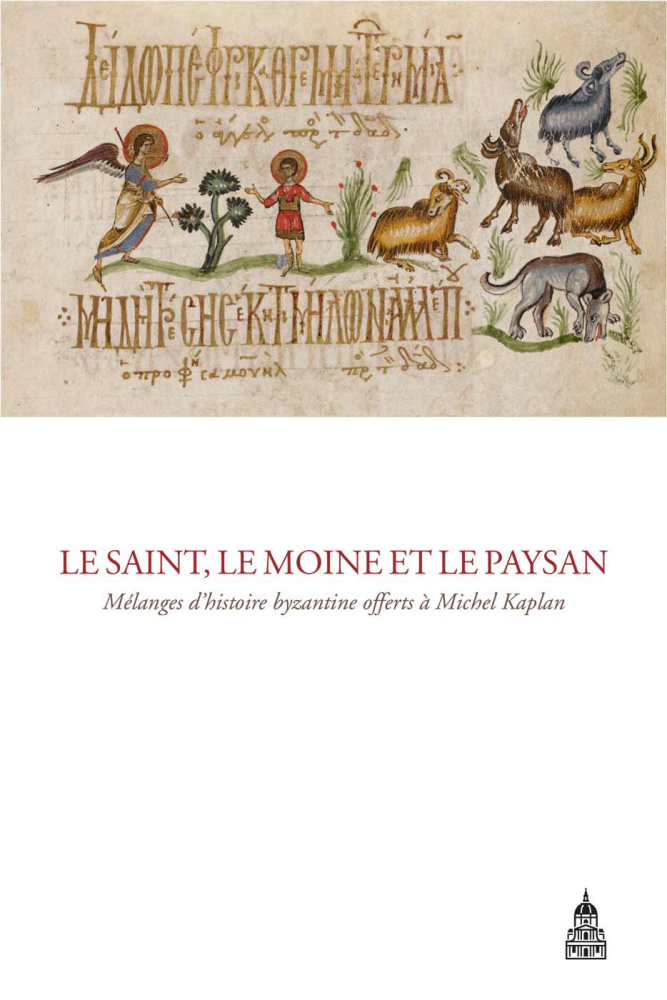
-
Volume de Collection
Byzance face aux Ottomans
exercice du pouvoir et contrôle du territoire sous les derniers Paléologues (milieu XIVe-milieu XVe siècle)
Numéro : 28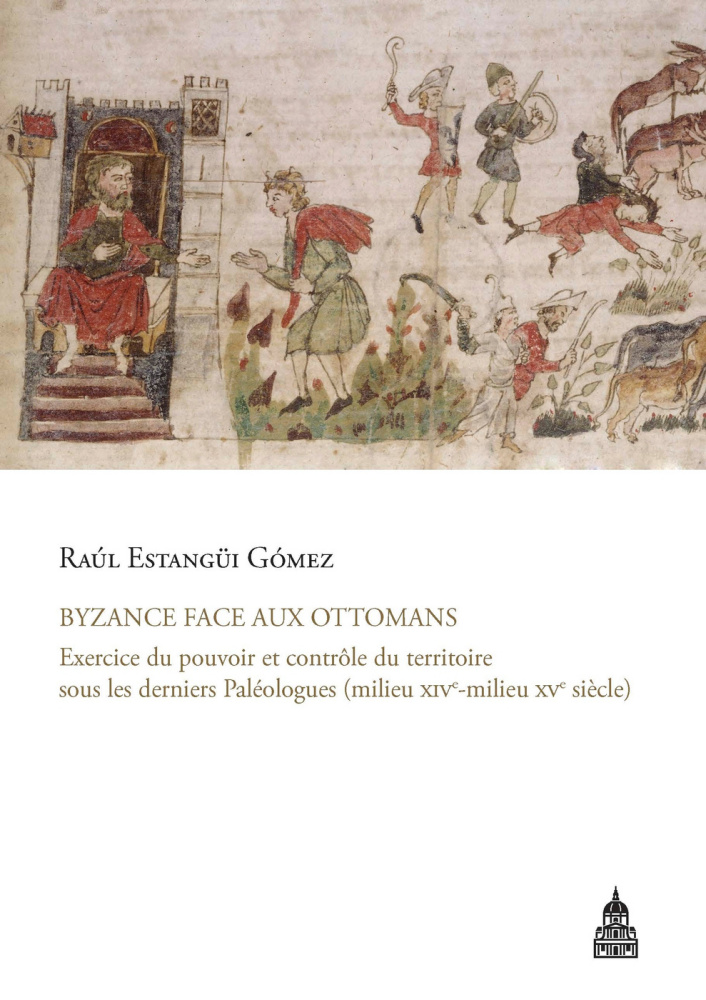
-
Volume de Collection
Théodore Agallianos, Dialogue avec un moine contre les Latins (1442)
Numéro : 27
-
Volume de Collection
Les saints ermites et moines dans la peinture murale byzantine
Numéro : 26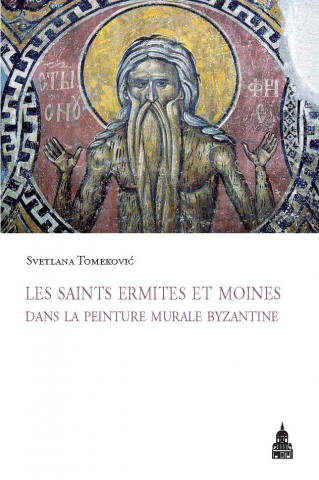
-
Volume de Collection
Évêques, pouvoir et société à Byzance (VIIIe-XIe siècle)
territoires, communautés et individus dans la société provinciale byzantine
Numéro : 25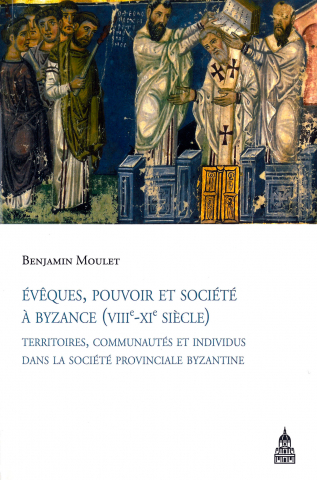
-
Volume de Collection
Économie et société à Byzance (VIIIe-XIIe siècle)
textes et documents
Numéro : 24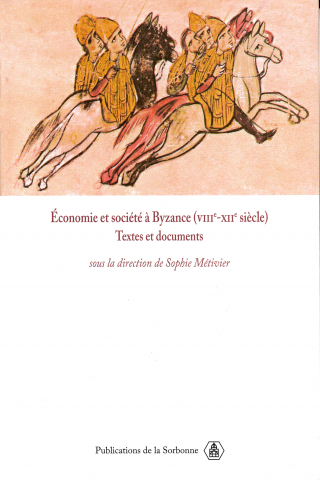
-
Volume de Collection
Monastères, images, pouvoirs et société à Byzance
Numéro : 23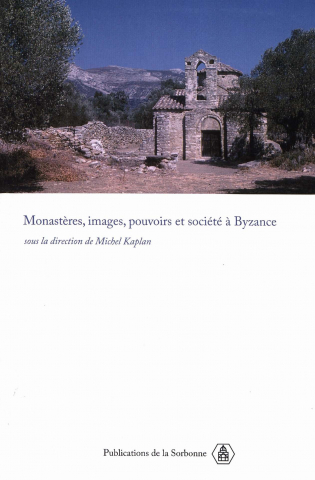
-
Volume de Collection
La Cappadoce (IVe-VIe siècle)
une histoire provinciale de l’Empire romain d’Orient
Numéro : 22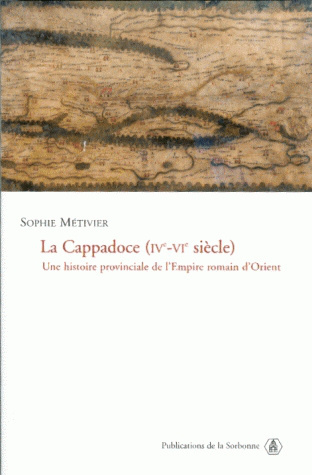
-
Volume de Collection
Byzance et le monde extérieur
contacts, relations, échanges
Numéro : 21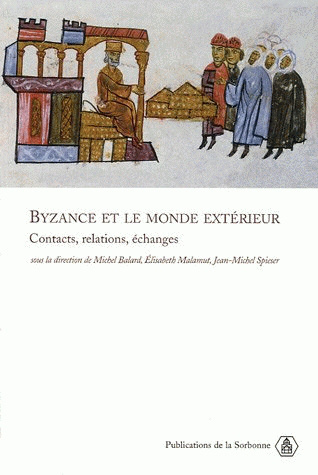
-
Volume de Collection
Chemins d’outre-mer
études d’histoire sur la Méditerranée médiévale offertes à Michel Balard
Numéro : 20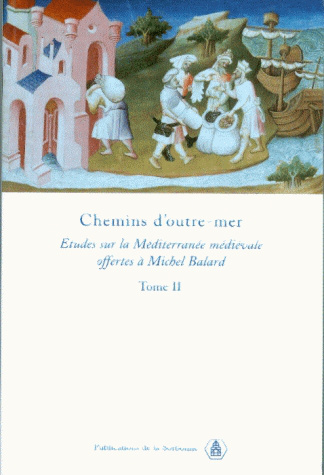
-
Volume de Collection
Migrations et diasporas méditerranéennes (Xe-XVIe siècles)
Colloque de Conques, 14-18 octobre 1999
Numéro : 19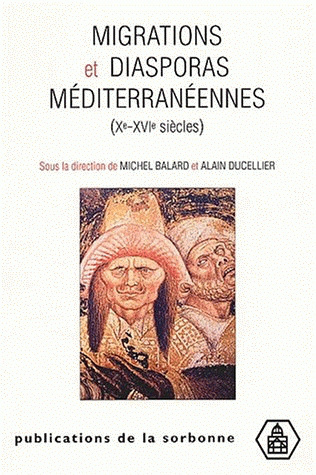
-
Volume de Collection
Le sacré et son inscription dans l’espace à Byzance et en Occident
études comparées
Numéro : 18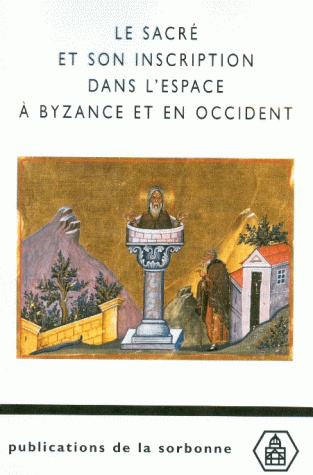
-
Volume de Collection
Le partage du monde
échanges et colonisation dans la Méditerranée médiévale
Numéro : 17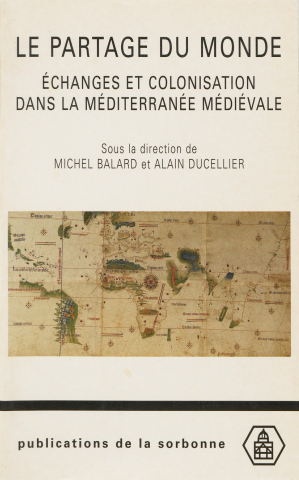
-
Volume de Collection
Εὐψυχία
mélanges offerts à Hélène Ahrweiler
Numéro : 16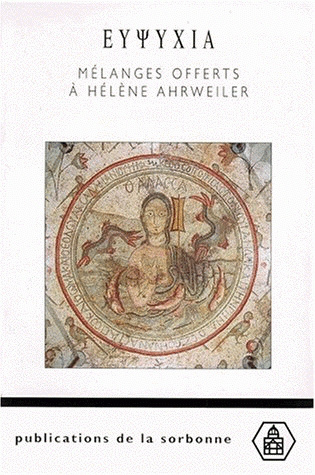
-
Volume de Collection
Le Péloponnèse du IVe au VIIIe siècle
changements et persistances
Numéro : 15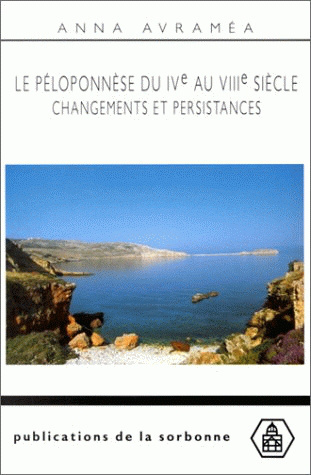
-
Volume de Collection
Autour de la première Croisade
actes du colloque de la Society for the study of the crusades and the latin East, (Clermont-Ferrand, 22-25 juin 1995)
Numéro : 14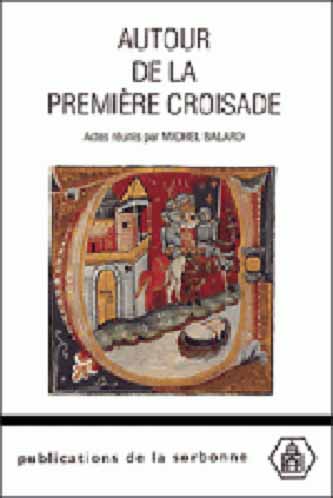
-
Volume de Collection
Grégoire Antiochos, Éloge du patriarche Basile Kamatèros
texte, traduction, commentaire suivis d’une analyse des œuvres de Grégoire Antiochos
Numéro : 13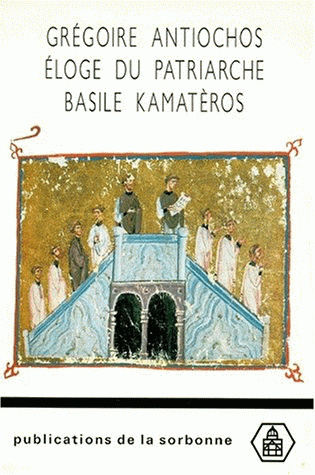
-
Volume de Collection
L’Arménie et Byzance
histoire et culture
Numéro : 12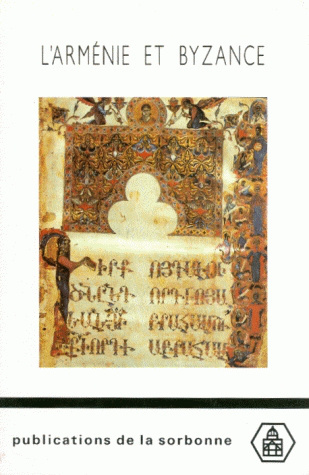
-
Volume de Collection
Les saints et leur sanctuaire à Byzance
textes images et monuments
Numéro : 11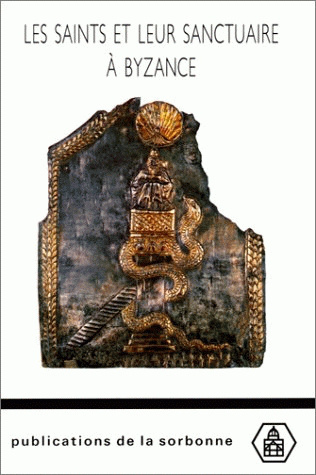
-
Volume de Collection
Les hommes et la terre à Byzance du VIe au XIe siècle
propriété et exploitation du sol
Numéro : 10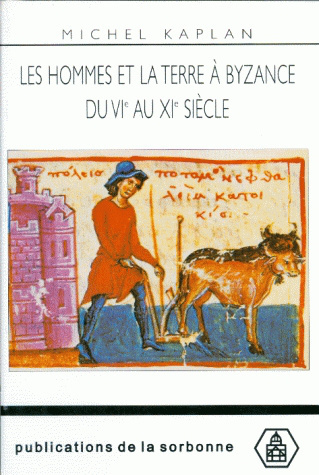
-
Volume de Collection
Pouvoir et contestations à Byzance (963-1210)
Numéro : 9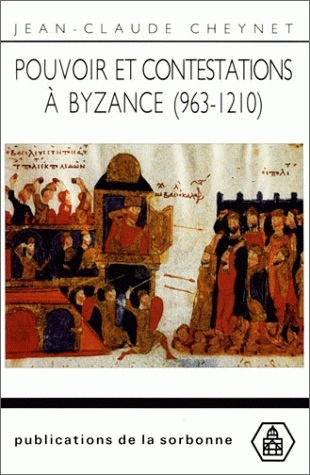
-
Volume de Collection
Les îles de l’Empire byzantin
VIIIe-XIIe siècles
Numéro : 8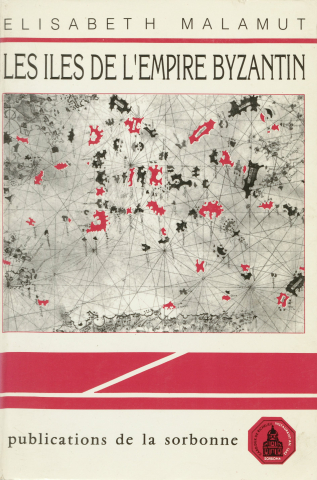
-
Volume de Collection
Géographie historique du monde méditerranéen
Numéro : 7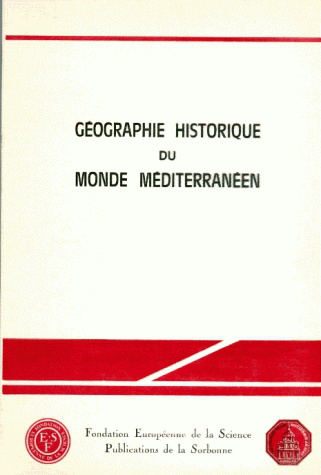
-
Volume de Collection
Les Italiens à Byzance
édition et présentations de documents
Numéro : 6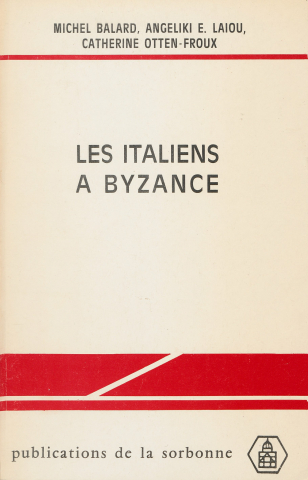
-
Volume de Collection
Études prosopographiques
Numéro : 5
-
Volume de Collection
Philadelphie et autres études
Numéro : 4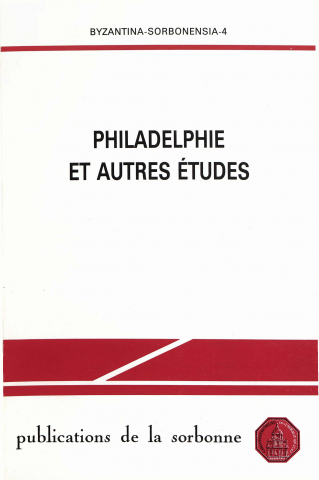
-
Volume de Collection
Geographica Byzantina
Numéro : 3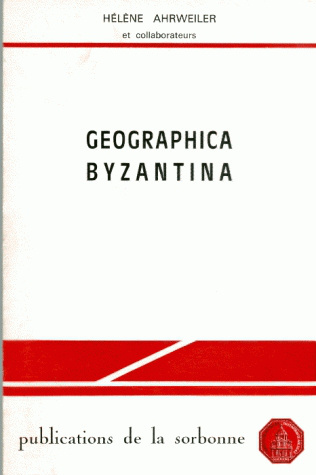
-
Volume de Collection
Les propriétés de la Couronne et de l’Église dans l’Empire byzantin
Ve-VIe siècles : documents
Numéro : 2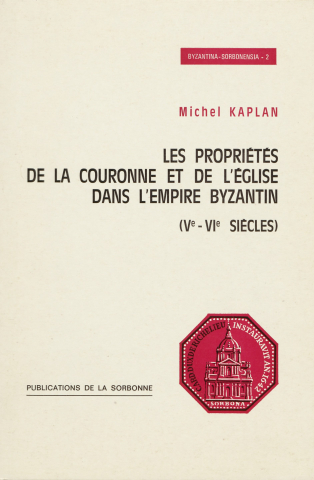
-
Volume de Collection
Familles byzantines : les Argyroi
IXe-XIIe siècles
Numéro : 1