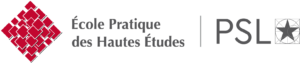Mission archéologique du Metn (Liban) : Ej-Jaouzé
Historique

Figure 1 – Le groupe de sarcophages devant le mont Sannine
La mission archéologique franco-libanaise d’Ej-Jaouzé (Metn, Liban) est l’aboutissement de prospections menées entre 2002 et 2004 centrées sur Ej-Jaouzé et sa région (Baskinta, Mamboukh, Ras el-Mrouj, Marjaba, Aïn el-Qabou, Zaarour, Bteghrine). Cette prospection a révélé notamment une nécropole à Marjaba, un petit établissement à Mamboukh, une fontaine avec dédicace à Ain el-Qabou, et une stèle funéraire inscrite à Bteghrine. Le relevé des vestiges au 1/20e fut effectué en 2003, accompagné d’un ramassage de céramique ; les premiers résultats en furent publiés dans la revue Bulletin d’archéologie et d’architecture libanaises (vol. 8, 2004). Les premières datations, basées sur l’expertise céramique, indiquaient une occupation de l’époque romaine et byzantine, avec un hiatus entre le VIIe s. et le XIIe s. Depuis 2012, une fouille de sauvetage, de quatre semaines annuellement, documente les différents secteurs et permet d’affiner la chronologie du site ; les prospections se poursuivent en parallèle. À partir de 2016, Lina Nacouzi et Dominique Pieri assurent la codirection de la mission qui est placée sous la tutelle de la Commission des fouilles du MAEDI.
Le site a échappé aux sources historiques au point que son nom antique est inconnu ; des voyageurs européens tels le diplomate Henri Guys (milieu du XIXe s.) ou le frère Simon Vailhé (fin du XIXe s.) ont visité le site et l’ont décrit, sans le dater ni l’analyser. La mission archéologique du Metn fut donc la première entreprise proprement archéologique à s’intéresser à ces vestiges.
Objectifs

Figure 2 – La résidence byzantine
Le site se situe à 1 400 m d’altitude, le long d’une ancienne route reliant Beyrouth à Damas. Il s’agit d’un habitat groupé qui s’étire en couronne autour d’une dépression centrale, sur 250 m N-S par 130 m ; un groupe de sarcophages et des carrières de calcaire complètent la zone archéologique (Fig. 1).
Ce village se compose d’une couronne d’habitations autour d’une dépression ayant pour origine une doline. Un grand bâtiment particulier (A), en position centrale, en bel appareil, constituait une villa agricole byzantine (Fig. 2).
Résultats
Une tranchée percée en travers de la doline qui s’étend au cœur du site indique une première fréquentation dès le début de l’âge du Bronze, peut-être des campements répétés de bûcherons venus exploiter la forêt de cèdres, qui se poursuit en pointillé tout au long de l’âge du Fer.
Nos travaux ont pu mettre en évidence qu’à l’époque byzantine le site abritait des thermes (Fig. 3). À cette époque, sa vocation est avant tout agricole, ainsi qu’en témoignent une panoplie d’outils agraires (houes, binettes, piochons… et cloches à bestiaux) et au moins deux grands pressoirs à vin (Fig. 4). Ils ont montré par ailleurs que le village existait déjà au Ve s., comme l’indiquent plusieurs tombes byzantines (Fig. 5). La présence chrétienne est manifeste des estampillées d’une croix, au nom d’un certain Maximos (Fig. 6), et par une eulogie au nom de saint Élie (Fig. 7). Les fouilles ont pu donner une date du début du VIIe s. pour l’abandon de cette phase chrétienne.

Figure 6 – Tuile estampillée avec croix

Figure 7 – Eulogie au nom de saint Élie
Le site semble déserté pendant plusieurs siècles. Les nouveaux arrivants (entre le Xe et le XIIe s.) transforment les lieux et y aménagent de petits ateliers sidérurgiques ; un four de réduction de minerai a été dégagé et les scories parsèment le site. La région est riche en minerai de fer (et en bois) et fut mentionnée comme telle par les géographes arabes médiévaux. Ce fer avait son importance dans le cadre du blocus économique exigé par la papauté vis-à-vis des pays musulmans. Aux XIIe et XIIIe s., la montagne connaît des confessions variées, chrétiens au nord, chiites et druzes au centre et au sud. Au tournant des XIIIe-XIVe s., après la chute de Tripoli aux mains des Mamlouks, la région fut le théâtre d’expéditions militaires contre les chiites par le gouverneur mamlouk de Damas et pour la sécuriser contre les menaces croisées (1291 marque la chute de la seigneurie de Beyrouth). Aux XIVe et XVe s., la région est devenue majoritairement sunnite. Une petite croix trouvée dans les niveaux médiévaux du site est à cet égard intéressante (Fig. 8). Le site et sa région riche en minerai de fer sont exploités jusqu’à l’époque moderne : la période ottomane est attestée (habitat, fréquentation, exploitation du fer et culture en terrasses pour toutes les productions fruitières, céréalières, vigne et olives). Ce n’est désormais plus qu’une zone de pâturage pour les chèvres.

Figure 8 – Croix-pendentif de bronze médiévale
–
Articles
Publications
Articles
• Alpi, Frédéric, « Ej-Jaouzé, fragment de tuile estampillée (M3-16) », Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaises 8, 2004, p. 248-250.
• Alpi, Frédéric, « Appendice : note épigraphique sur la voûte inscrite de Aïn al-Qabou », dans La pioche et la plume : autour du Soudan, du Liban et de la Jordanie : hommages archéologiques à Patrice Lenoble, Vincent Rondot, Frédéric Alpi & François Villeneuve (dir.), Paris, 2011, p. 143-144.
• Nacouzi, Lina, « Ej-Jaouze (Metn, Liban). Mission de 2003 », Bulletin d’archéologie et d’architecture libanaises 8, 2004, p. 211-247.
• Nacouzi, Lina, « La source de Aïn el-Qabou (Metn), son inscription et les vestiges des environs », dans Vincent Rondot, Frédéric Alpi et François Villeneuve (dir.), La pioche et la plume : autour du Soudan, du Liban et de la Jordanie : hommages archéologiques à Patrice Lenoble, Paris, 2011, p. 131-142.
• Nacouzi, Lina, et al. « Ej-Jaouzé (Metn). Rapport des travaux menés en 2012-2013 », avec les contributions de Dominique Pieri et Tania Zaven, Bulletin d’archéologie et d’architecture libanaises, 16, 2016, p. 131 – 192.
• Nacouzi, Lina, et al. « Ej-Jaouzé (Metn). Rapport des travaux menés en 2014, 2015 et 2016 », avec la collaboration d’Emmanuelle Capet et Gérard Charpentier et avec les contributions de Frédéric Alpi, Jwana Chahoud, Marie Laguardia, Gaspard Pagès, Dominique Pieri et Vivien Prigent, Bulletin d’archéologie et d’architecture libanaises, 18, 2018, p. 79-200.
• Pieri, Dominique, « Note préliminaire sur la céramique d’Ej-Jaouzé », Bulletin d’archéologie et d’architecture libanaises, 8, 2004, p. 252-261.
• Pieri, Dominique, « Résultats préliminaires sur la céramique d’Ej-Jaouzé (2012-2013), Bulletin d’archéologie et d’architecture libanaises, 16, 2016 p. 163-186.