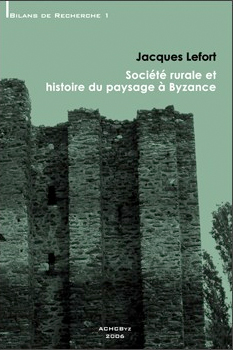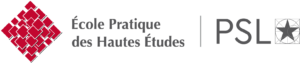Bilans de recherche
La collection Bilans de recherche, éditée par l’Association des Amis du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance, offre des recueils thématiques par des byzantinistes de renom. À ce jour, quinze volumes ont paru à un rythme soutenu depuis 2006.
-
Volume de Collection
At the foot of the Great Caucasus
1, Gods, humans, stones ; 2, Letters, sciences, history
Numéro : 15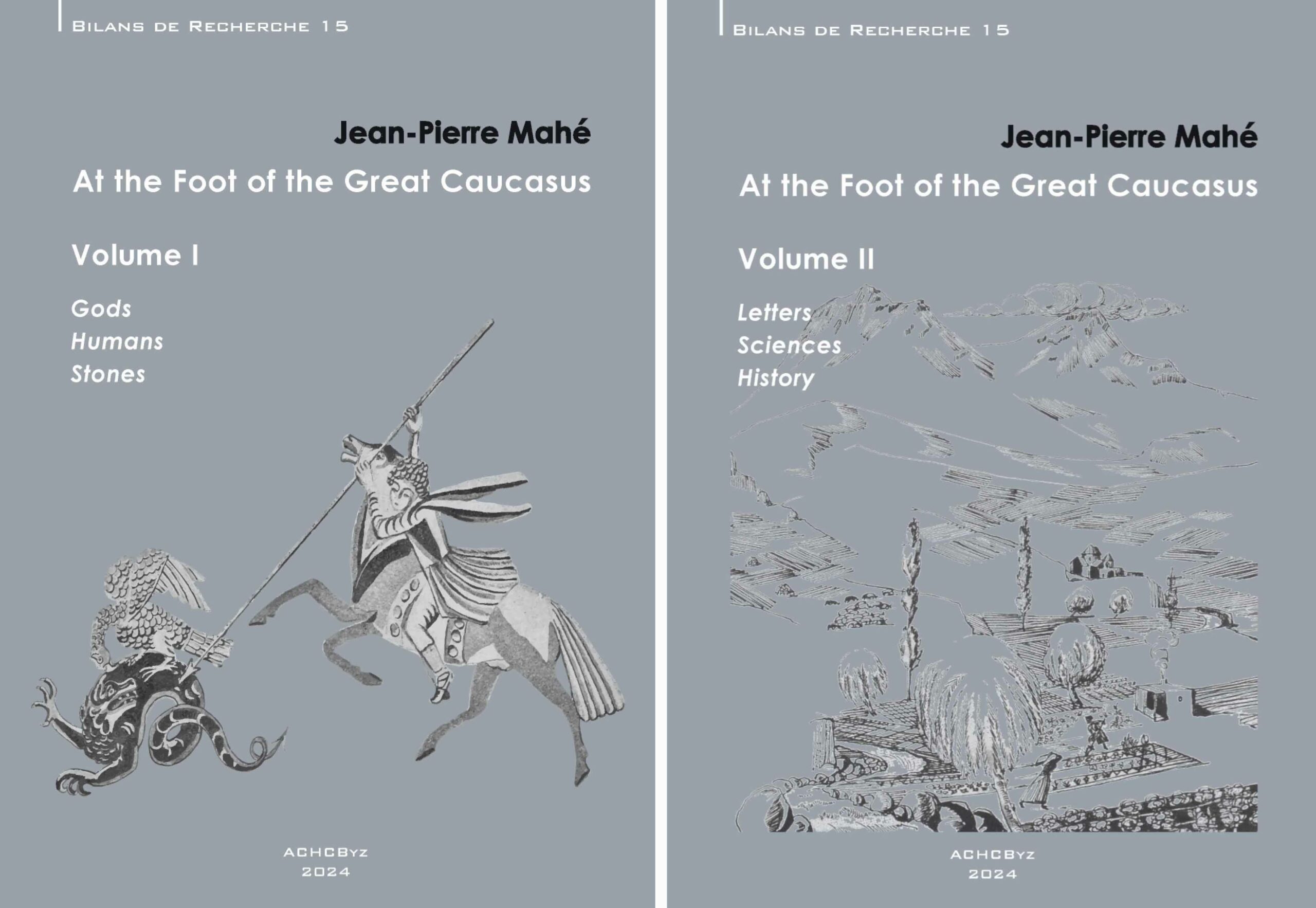
-
Volume de Collection
La fabrique du livre à Byzance
Numéro : 14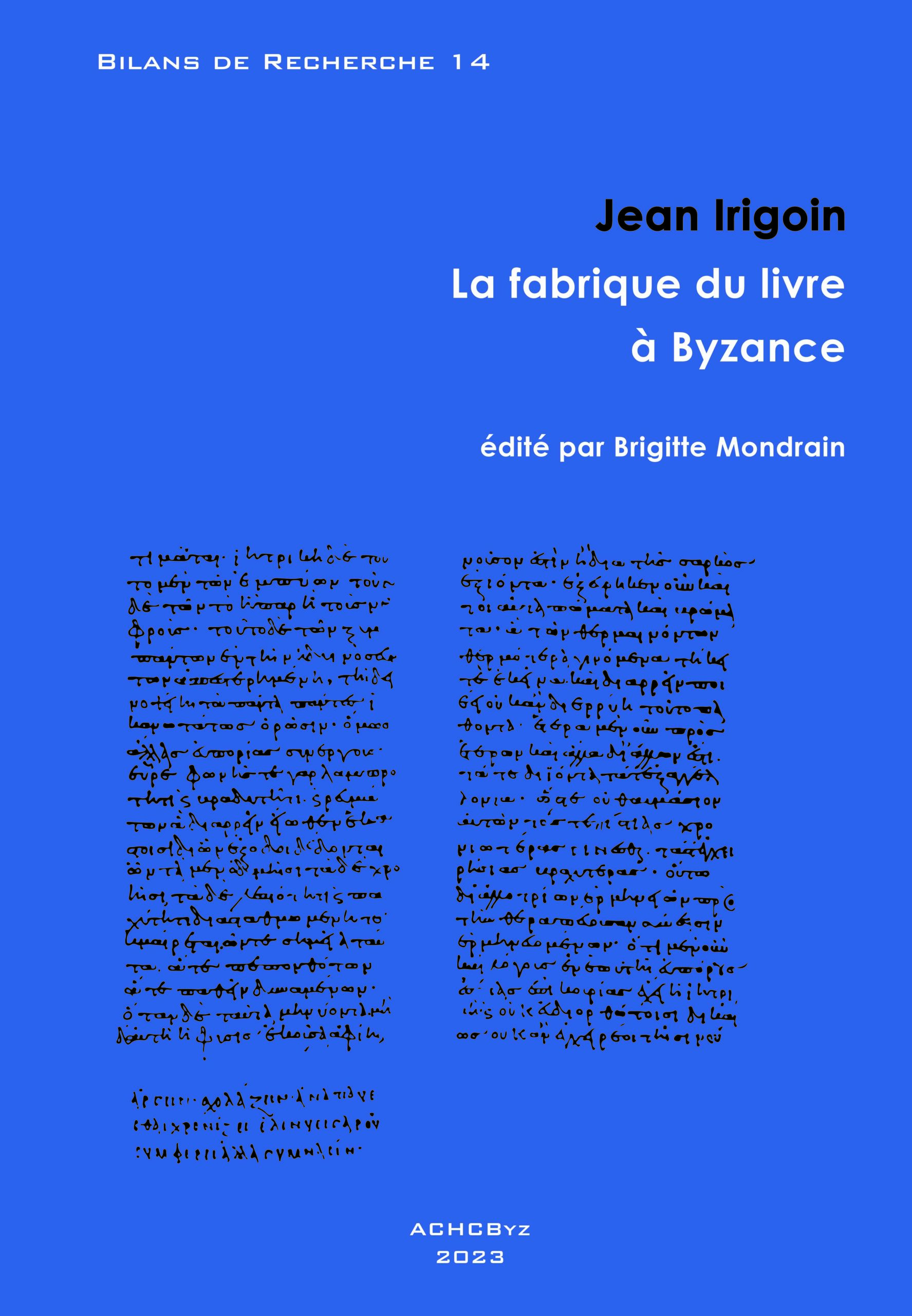
-
Volume de Collection
Monuments et images de Byzance
Numéro : 13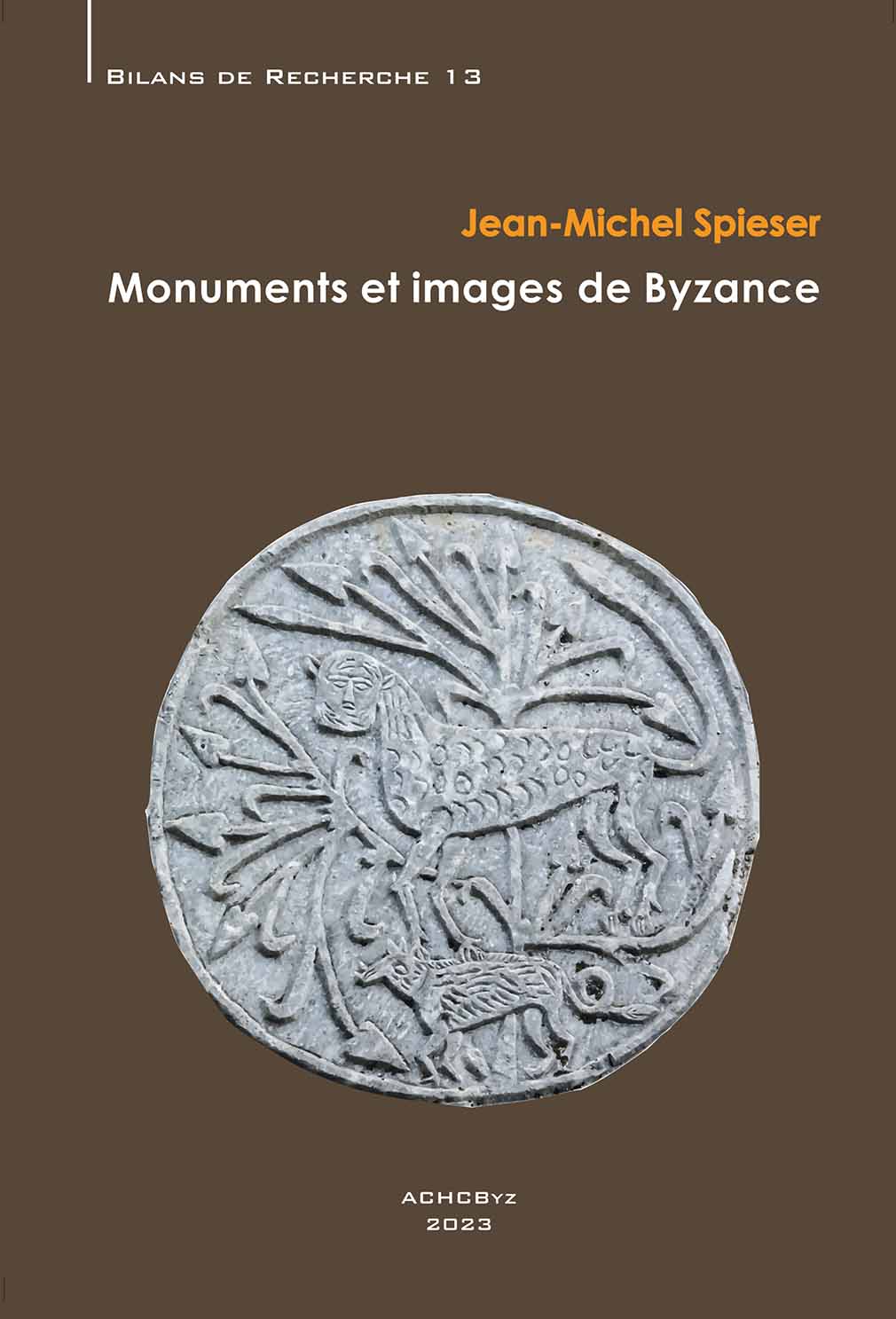
-
Volume de Collection
Morts vivants, tombes et mausolées en terre d’Islam
Numéro : 12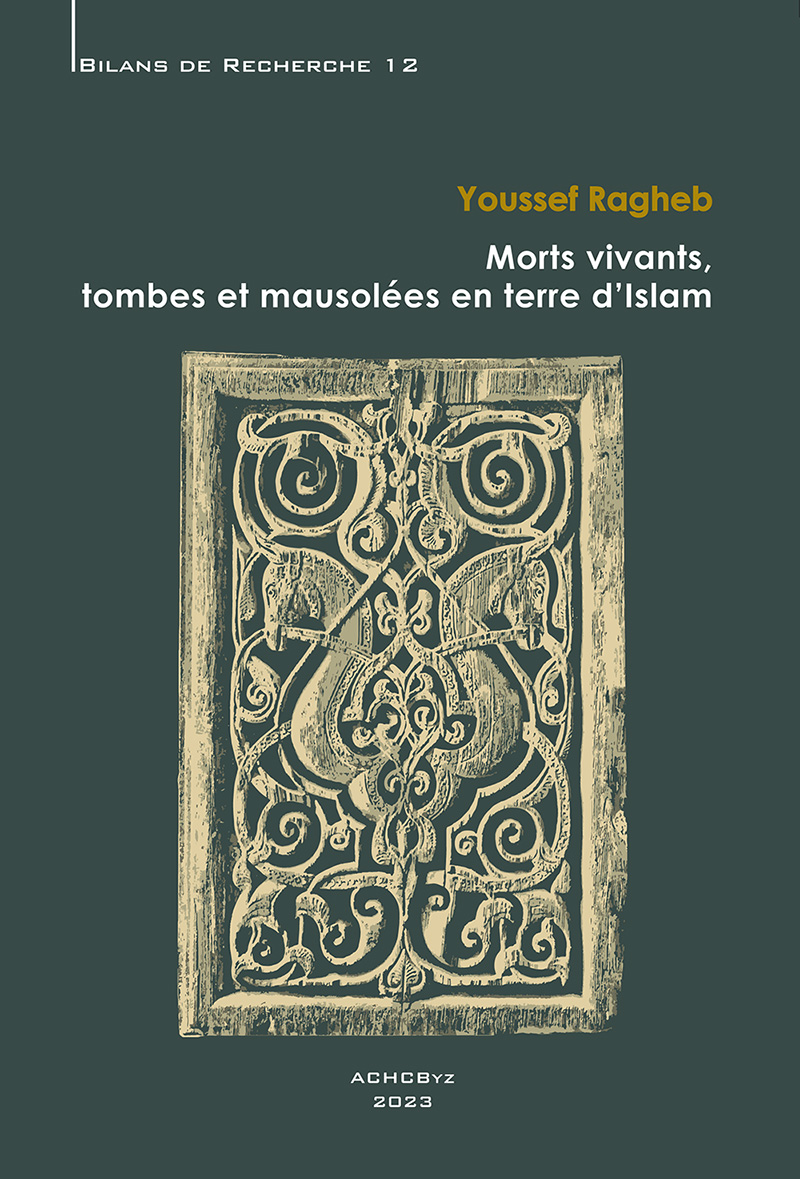
-
Volume de Collection
Corps naissant, corps souffrant
anthropologie, médecine, épidémies à Byzance
Numéro : 11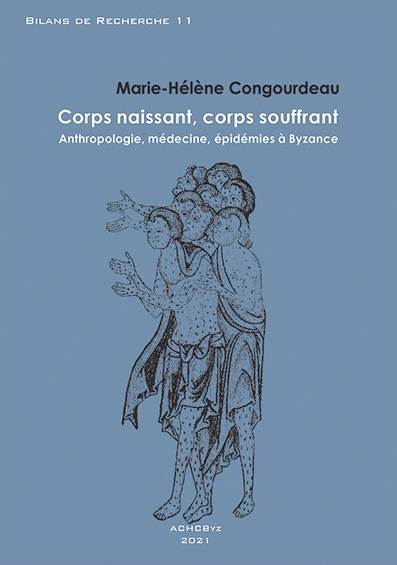
-
Volume de Collection
Études d’épigraphie et d’histoire des premiers siècles de Byzance
Numéro : 10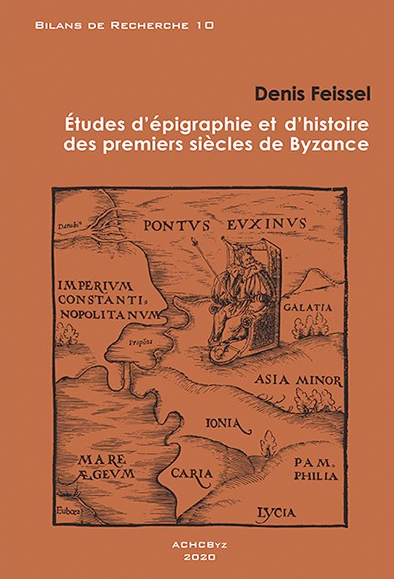
-
Volume de Collection
Byzance et l’Italie méridionale
Numéro : 9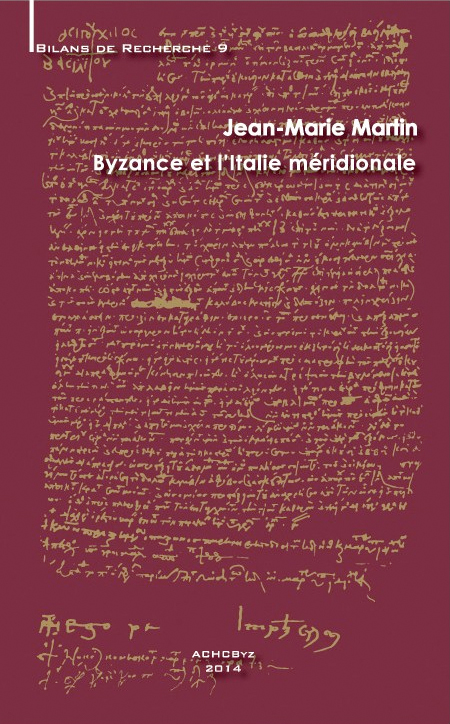
-
Volume de Collection
Idées byzantines
Numéro : 8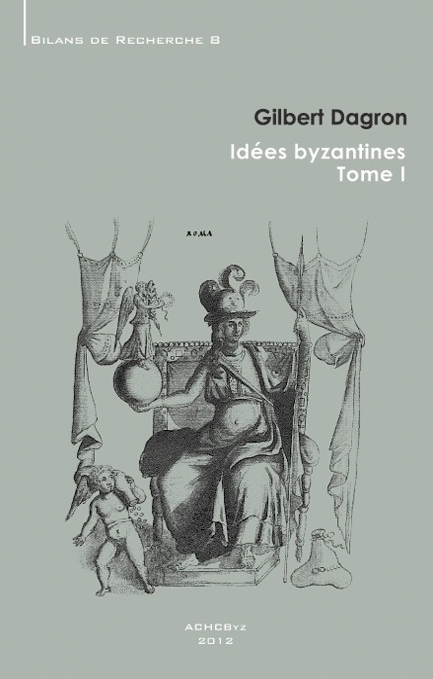
-
Volume de Collection
Documents, droit, diplomatique de l’Empire romain tardif
Numéro : 7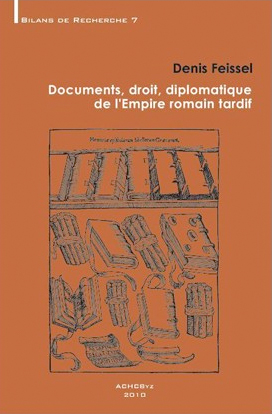
-
Volume de Collection
Femmes, patrimoines, normes à Byzance
Numéro : 6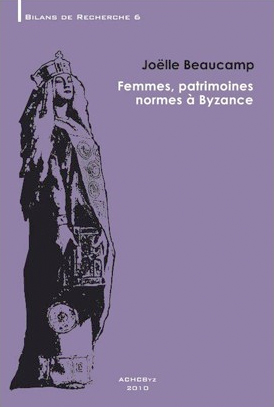
-
Volume de Collection
Juifs et chrétiens en Orient byzantin
Numéro : 5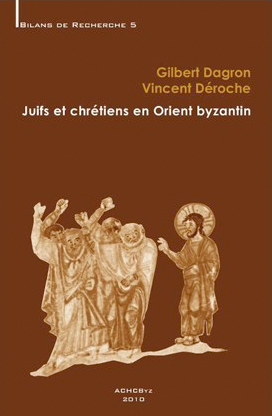
-
Volume de Collection
Fiscalité et société en Égypte byzantine
Numéro : 4
-
Volume de Collection
La société byzantine
l'apport des sceaux
Numéro : 3
-
Volume de Collection
L’histoire des iconoclastes
Numéro : 2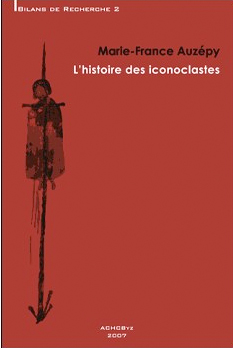
-
Volume de Collection
Société rurale et histoire du paysage à Byzance
Numéro : 1