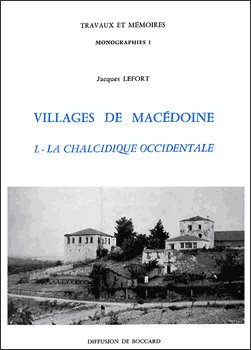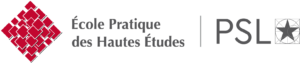Monographies
Monographies du Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance – Collège de France
Collection fondée en 1982 par Gilbert Dagron et éditée par De Boccard jusqu’en 2000, puis par l’Association des amis du Centre d’histoire et civilisation de Byzance (ACHCByz).
À partir de 2016, la collection Monographies est éditée par Typographia Byzantina et publiée par Peeters.
-
Volume de Collection
L’Eurasie autour de l’an 1000
cultures, religions et sociétés d’un monde en développement
Numéro : 57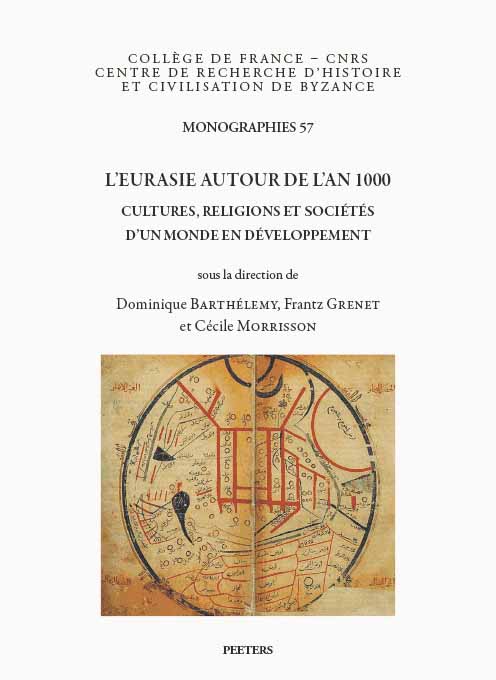
-
Volume de Collection
Une société chrétienne
Naples, Amalfi, Gaète (VIe-XIIe siècle)
Numéro : 56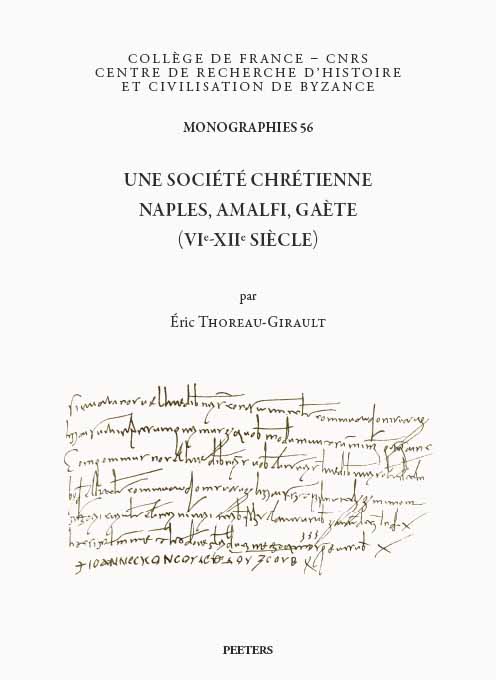
-
Volume de Collection
Culte des saints et littérature hagiographique
accords et désaccords
Numéro : 55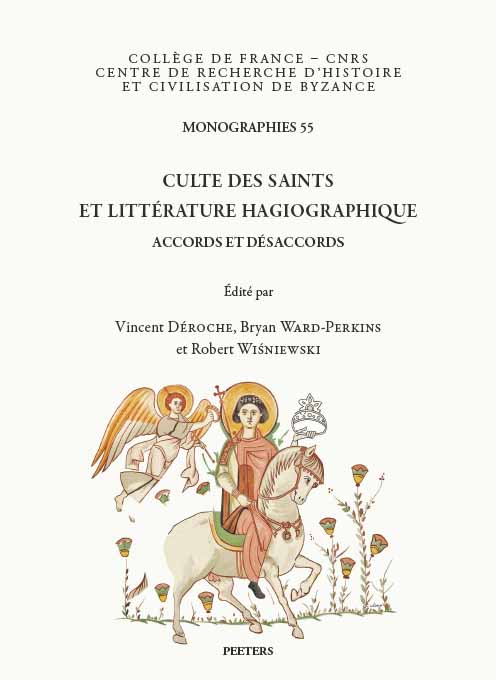
-
Volume de Collection
Maxime Planoudès, Lettres
Numéro : 54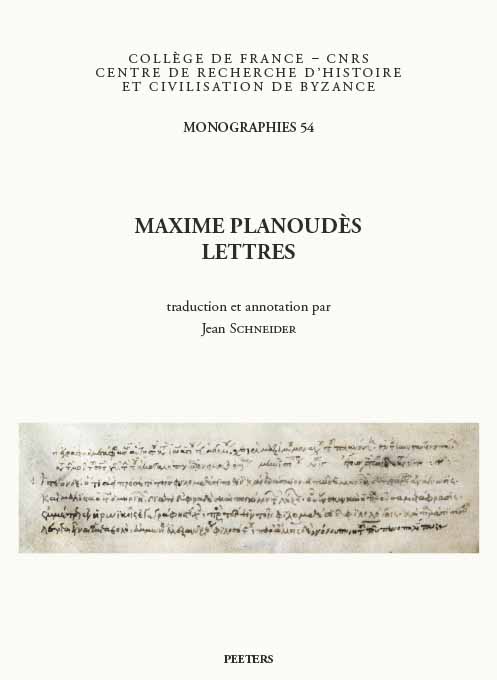
-
Volume de Collection
Sirmium à l’époque des grandes migrations
Numéro : 53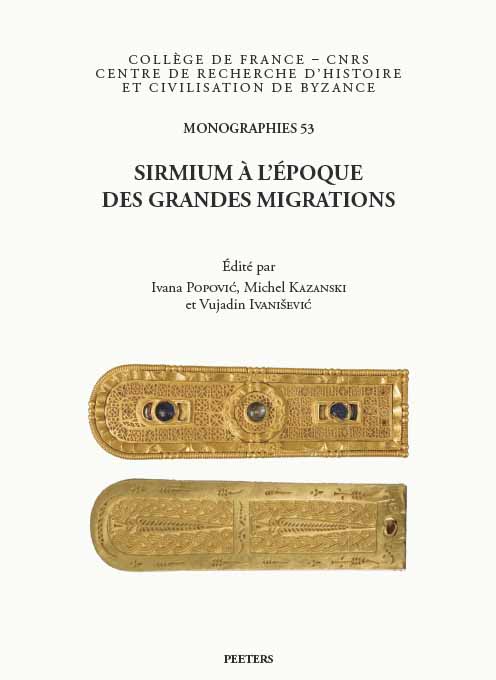
-
Volume de Collection
Constantinople et les provinces d’Asie Mineure, IXe-XIe siècle
administration impériale, sociétés locales et rôle de l’aristocratie
Numéro : 52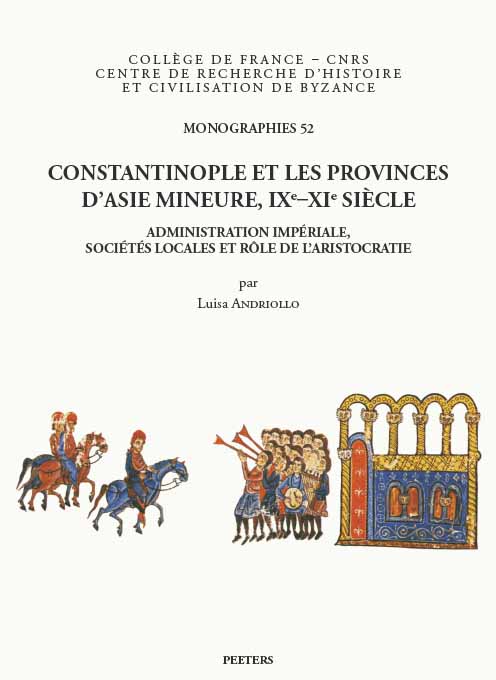
-
Volume de Collection
L’Union à l’épreuve du formulaire
professions de foi entre Églises d’Orient et d’Occident (XIIIe-XVIIIe siècle)
Numéro : 51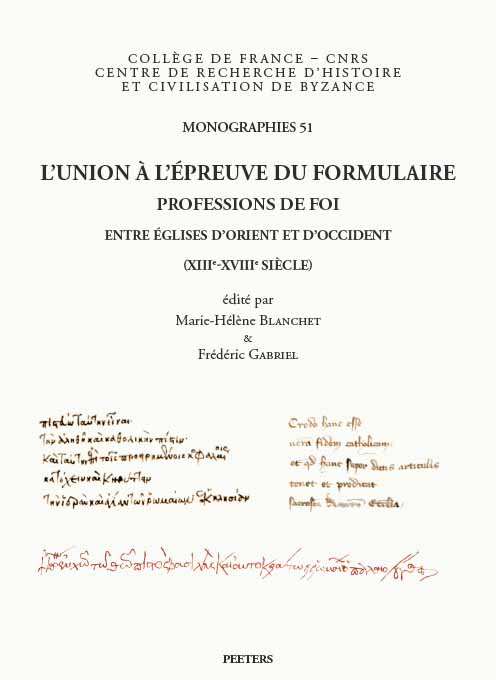
-
Volume de Collection
Hoṙomos Monastery
art and history
Numéro : 50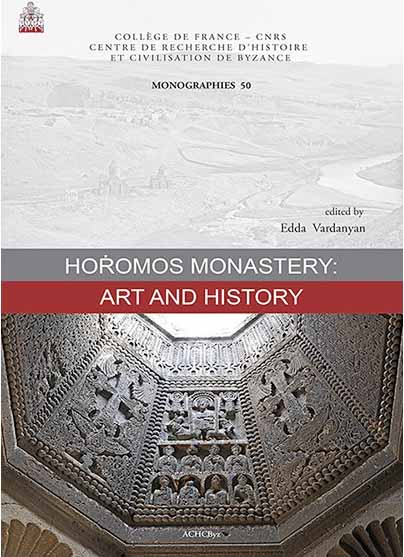
-
Volume de Collection
Lewond Vardapet, Discours historique
avec en annexe la Correspondance d’Omar et de Léon
Numéro : 49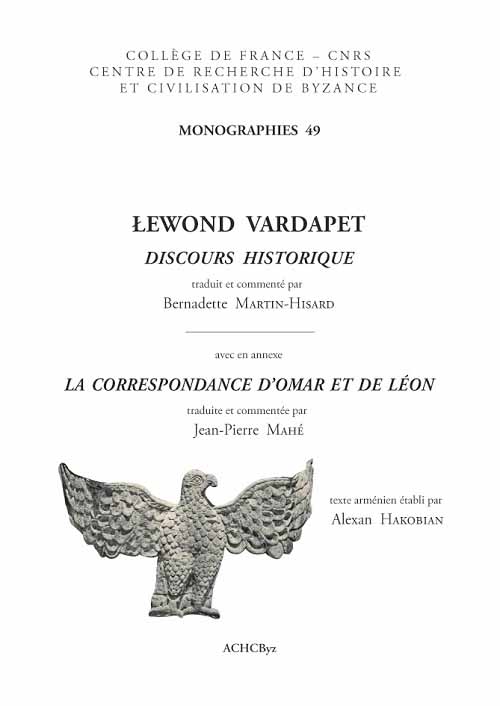
-
Volume de Collection
Michel Psellos, Portraits de famille
Numéro : 48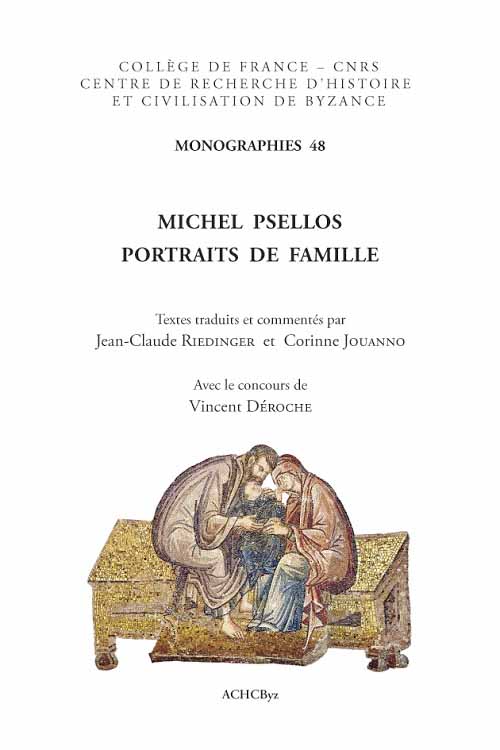
-
Volume de Collection
“Pearls before swine”
missionary work in Byzantium
Numéro : 47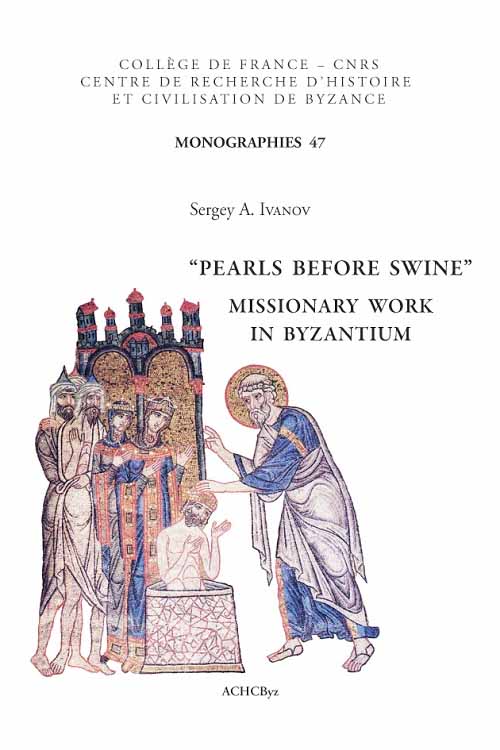
-
Volume de Collection
Nourritures terrestres, nourritures célestes
la culture alimentaire à Byzance
Numéro : 46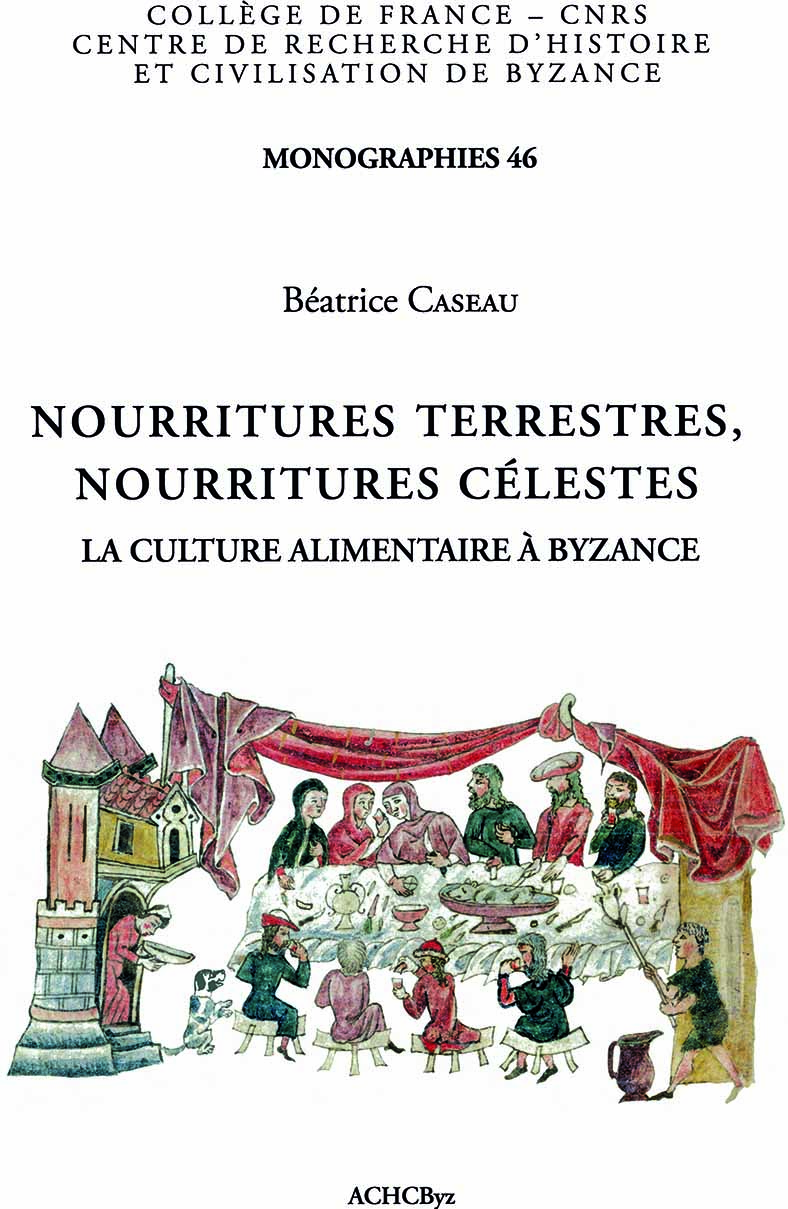
-
Volume de Collection
Inheritance, law and religions in the ancient and mediaeval worlds
Numéro : 45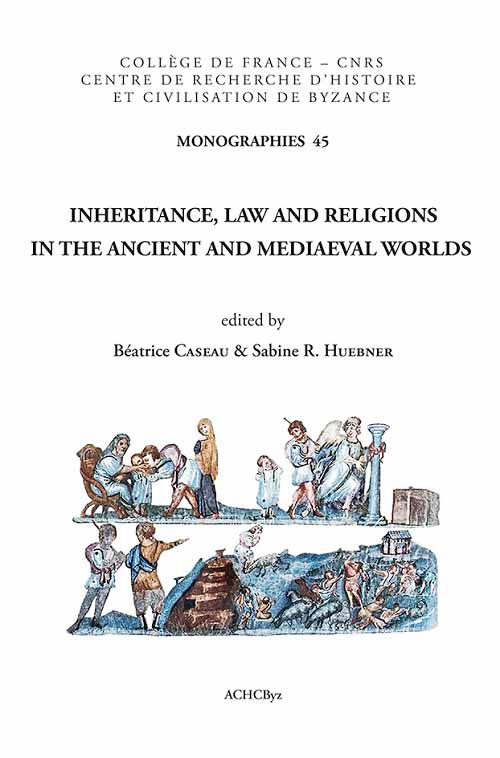
-
Volume de Collection
Prostituées repenties et femmes travesties dans l’hagiographie géorgienne
Numéro : 44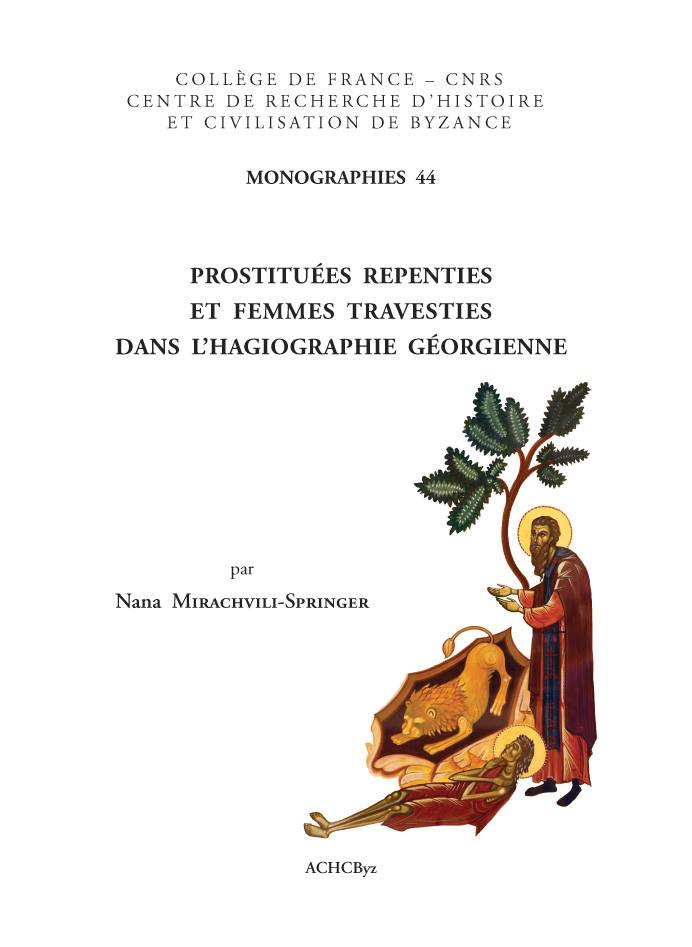
-
Volume de Collection
Richesse et croissance au Moyen Âge
Orient et Occident
Numéro : 43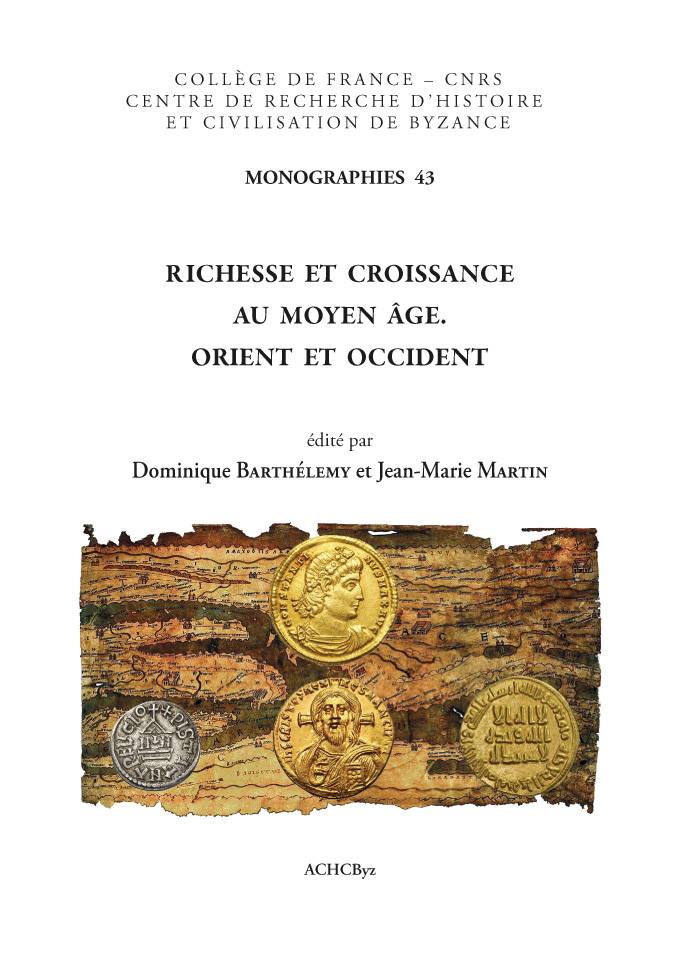
-
Volume de Collection
Thessalonique au temps des Zélotes (1342-1350)
actes de la table ronde organisée dans le cadre du 22e Congrès international des études byzantines, à Sofia, le 25 août 2011
Numéro : 42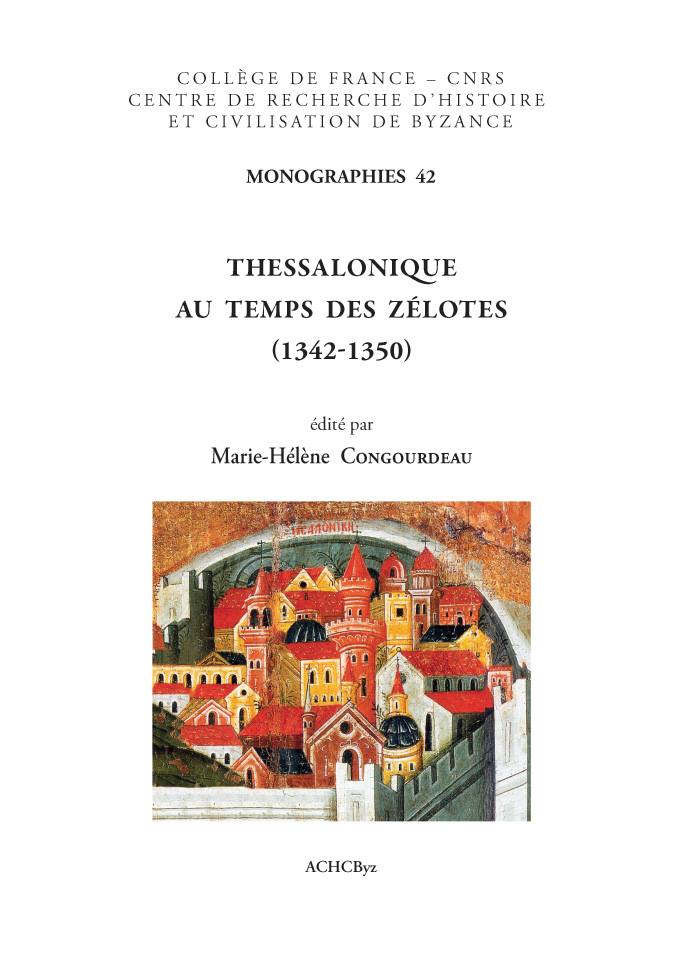
-
Volume de Collection
Mnogosložnyj Svitok
the Slavonic letter of the three patriarchs to Emperor Theophilos
Numéro : 41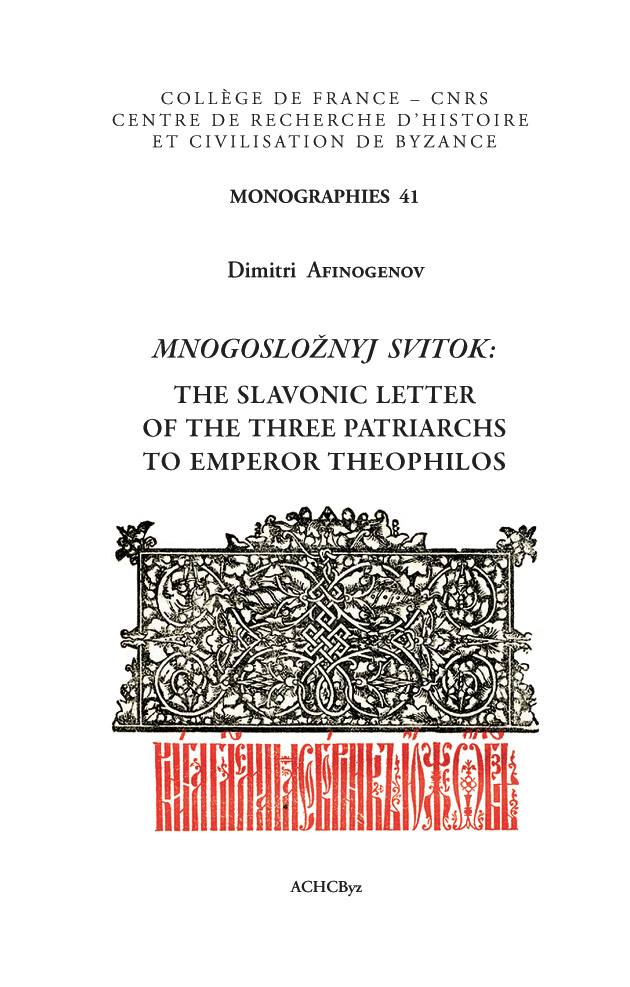
-
Volume de Collection
Léon le Diacre, Empereurs du Xe siècle
présentation, traduction et notes
Numéro : 40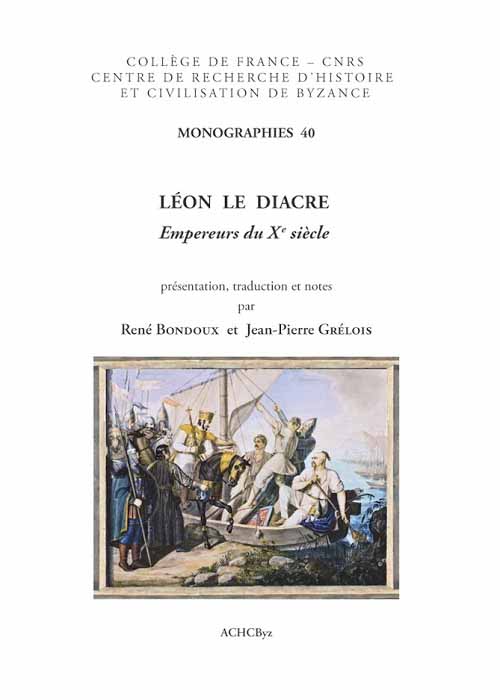
-
Volume de Collection
Réduire le schisme ?
ecclésiologies et politiques de l’Union entre Orient et Occident (XIIe-XVIIIe siècle)
Numéro : 39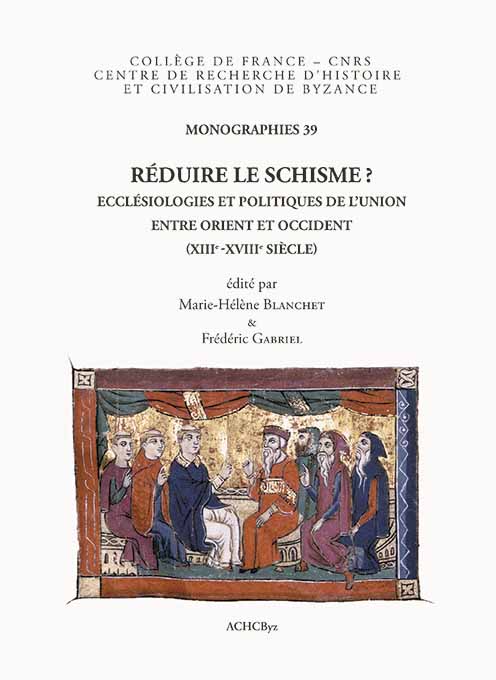
-
Volume de Collection
Géoponiques
Numéro : 38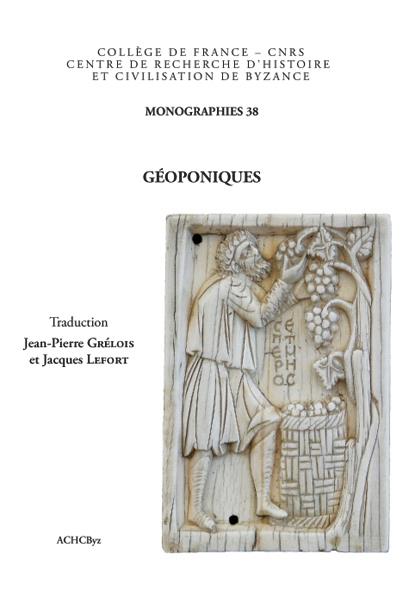
-
Volume de Collection
Les réseaux familiaux
Antiquité tardive et Moyen Âge
Numéro : 37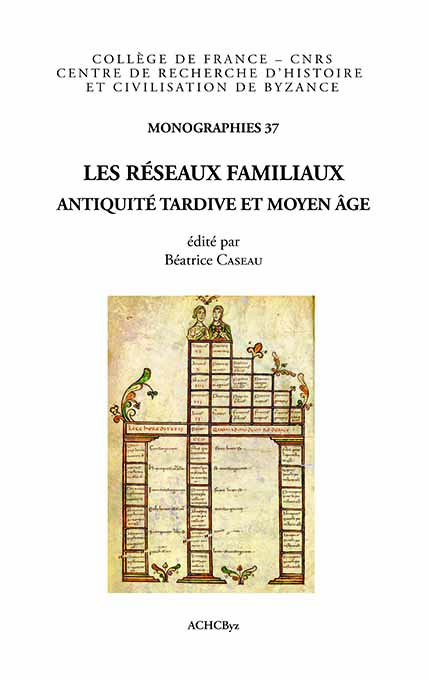
-
Volume de Collection
The Pontic-Danubian realm in the period of the Great Migration
Numéro : 36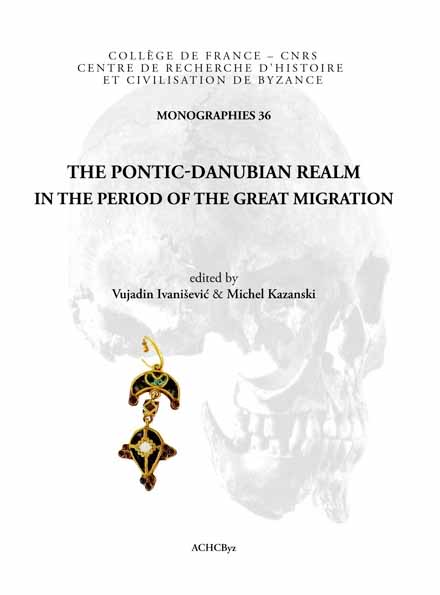
-
Volume de Collection
Liquid & multiple
individuals & identities in the thirteenth-century Aegean
Numéro : 35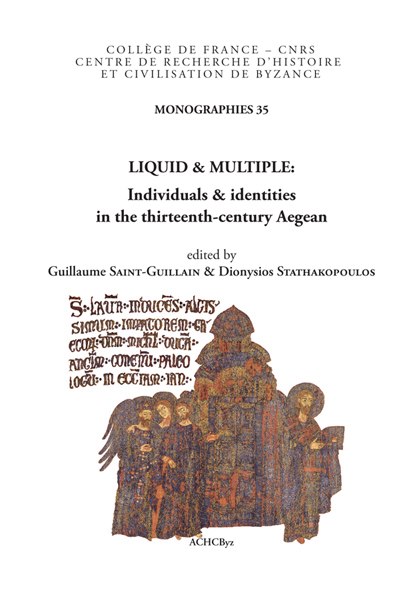
-
Volume de Collection
La collection canonique d’Antioche
droit et hérésie à travers le premier recueil de législation ecclésiastique (IVe siècle)
Numéro : 34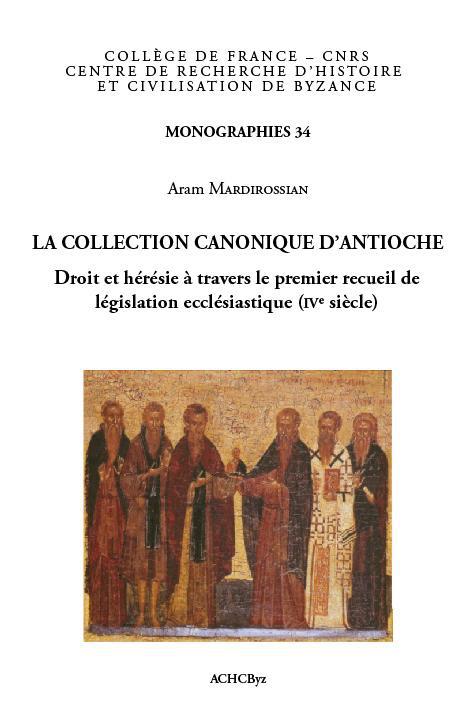
-
Volume de Collection
Sceaux byzantins de la collection D. Theodoridis
les sceaux patronymiques
Numéro : 33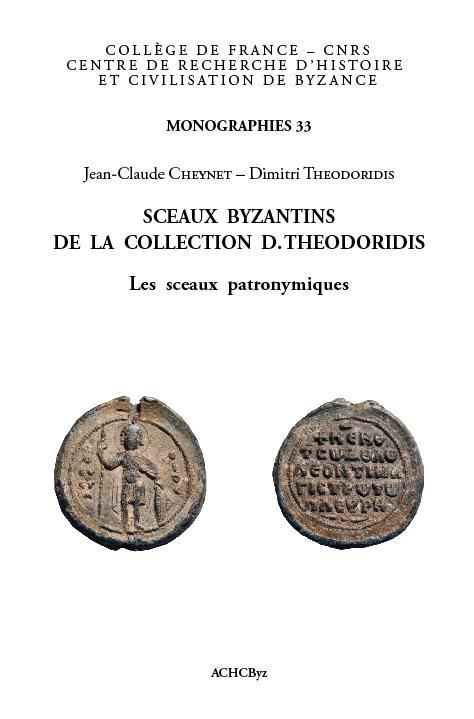
-
Volume de Collection
Juifs et chrétiens en Arabie aux Ve et VIe siècles
regards croisés sur les sources
Numéro : 32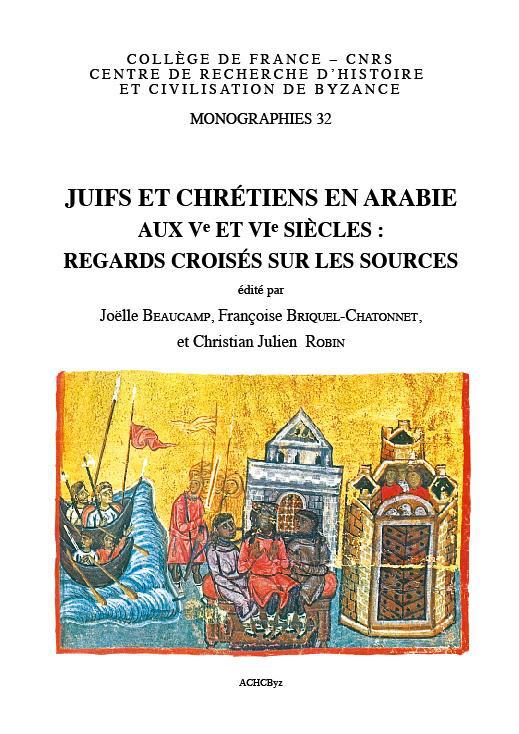
-
Volume de Collection
Guerre et société au Moyen Âge
Byzance-Occident (VIIIe-XIIIe siècle)
Numéro : 31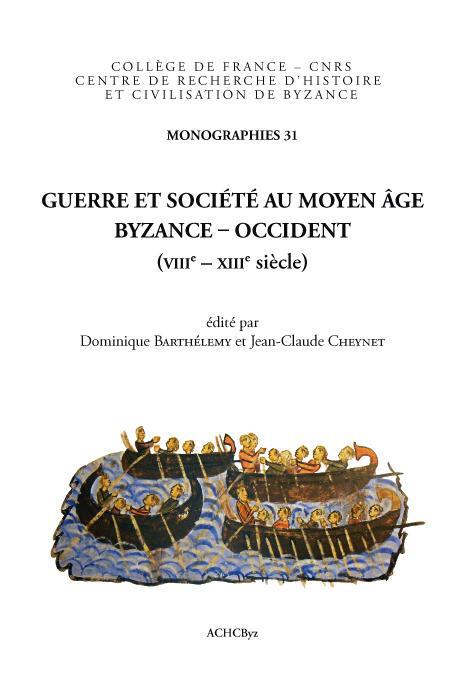
-
Volume de Collection
Puer Apuliae
mélanges offerts à Jean-Marie Martin
Numéro : 30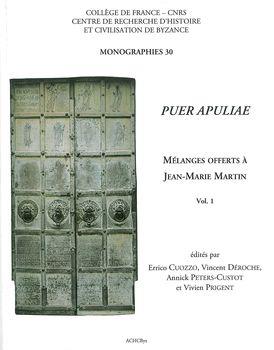
-
Volume de Collection
Oralité et lien social au Moyen Âge (Occident, Byzance, Islam)
parole donnée, foi jurée, serment
Numéro : 29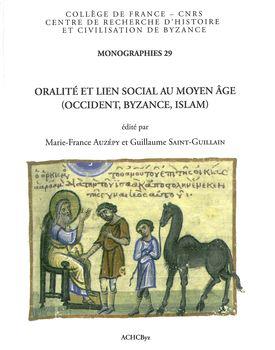
-
Volume de Collection
Pierre Gilles, Itinéraires byzantins
Lettre à un ami. Du Bosphore de Thrace. De la topographie de Constantinople et de ses antiquités
Numéro : 28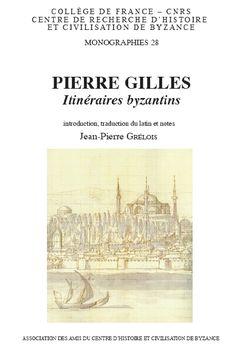
-
Volume de Collection
Le martyre de Saint Aréthas et de ses compagnons (BHG 166)
Numéro : 27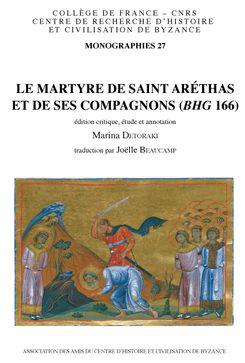
-
Volume de Collection
L’embryon et son âme dans les sources grecques
(VIe siècle av. J.-C. – Ve siècle après J.-C.)
Numéro : 26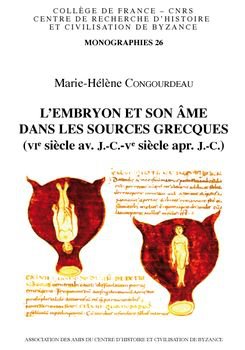
-
Volume de Collection
La Crimée entre Byzance et le Khaganat khazar
Numéro : 25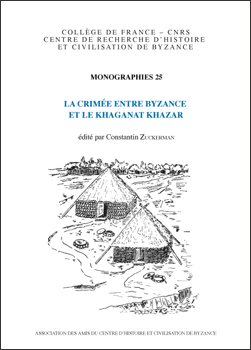
-
Volume de Collection
Recherches sur la Chronique de Jean Malalas. 2
Numéro : 24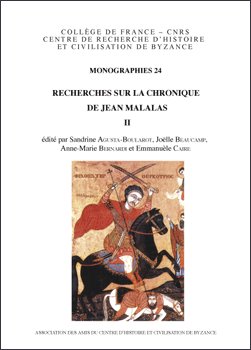
-
Volume de Collection
Pèlerinages et lieux saints dans l’Antiquité et le Moyen Âge
mélanges offerts à Pierre Maraval
Numéro : 23
-
Volume de Collection
Les nécropoles de Viminacium à l’époque des Grandes Migrations
Numéro : 22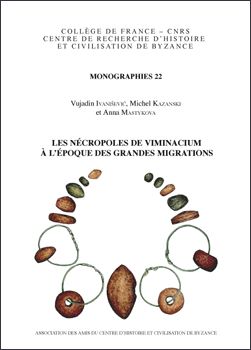
-
Volume de Collection
La fortune des grands monastères byzantins
fin du Xe – milieu du XIVe siècle
Numéro : 21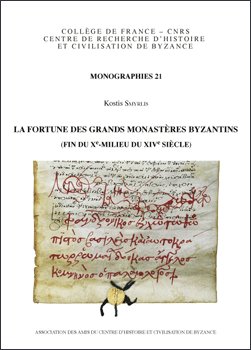
-
Volume de Collection
Chroniques d’épigraphie byzantine. 1987-2004
Numéro : 20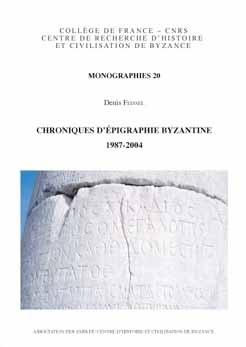
-
Volume de Collection
Lire et écrire à Byzance
Numéro : 19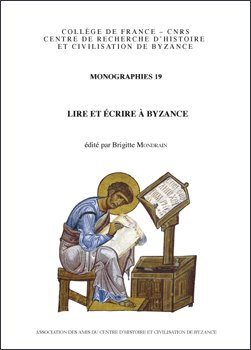
-
Volume de Collection
Discours annuels en l’honneur du patriarche Georges Xiphilin
Numéro : 18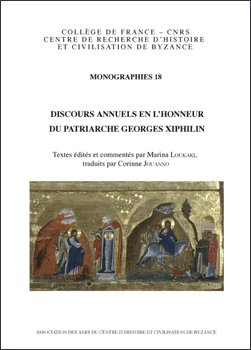
-
Volume de Collection
Byzance et les reliques du Christ
Numéro : 17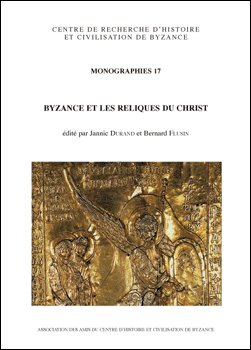
-
Volume de Collection
Du village à l’Empire
autour du registre fiscal d’Aphroditô (525/526)
Numéro : 16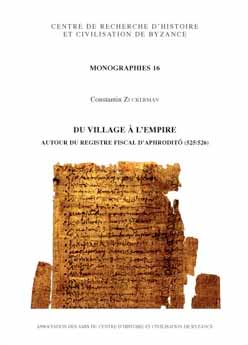
-
Volume de Collection
Recherches sur la Chronique de Jean Malalas. 1
Numéro : 15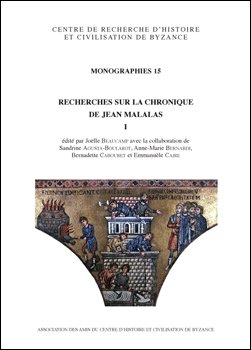
-
Volume de Collection
La pétition à Byzance
Numéro : 14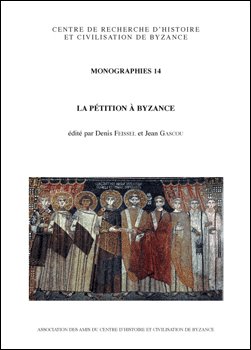
-
Volume de Collection
Recherches sur les notables municipaux dans l’Empire protobyzantin
Numéro : 13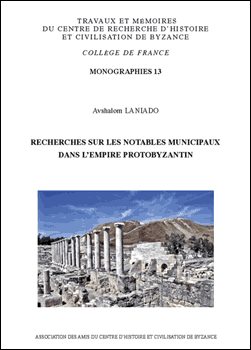
-
Volume de Collection
Recueil des inscriptions grecques chrétiennes des Cyclades
de la fin du IIIe au VIIe s. après J.-C.
Numéro : 12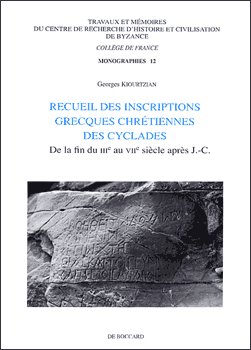
-
Volume de Collection
La transmission du patrimoine : Byzance et l’aire méditerranéenne
actes d’une table ronde tenue au Collège de France (24 et 25 novembre 1995)
Numéro : 11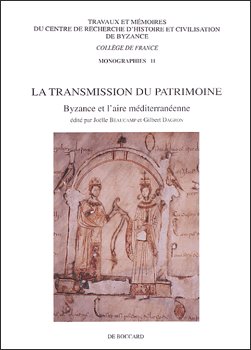
-
Volume de Collection
Des Parthes au Califat
quatre leçons sur la formation de l’identité arménienne
Numéro : 10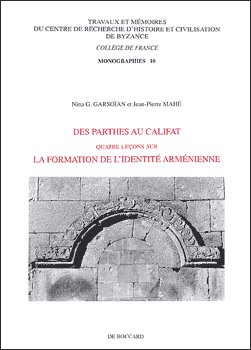
-
Volume de Collection
Constantinople médiévale
études sur l’évolution des structures urbaines
Numéro : 9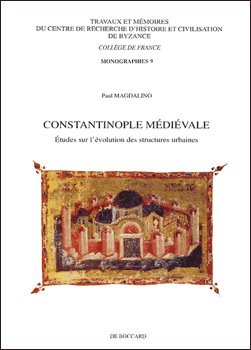
-
Volume de Collection
Le traité d’urbanisme de Julien d’Ascalon
droit et architecture en Palestine au VIe siècle
Numéro : 8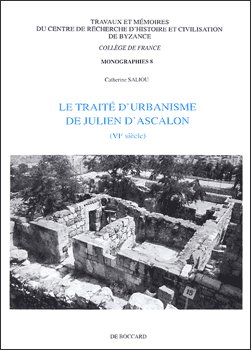
-
Volume de Collection
Mariage, amour et parenté à Byzance aux XIe-XIIIe siècles
Numéro : 7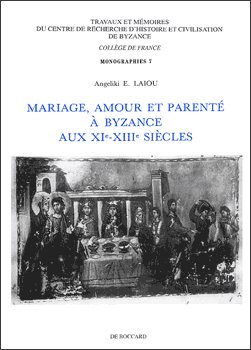
-
Volume de Collection
Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle).
2, Les pratiques sociales
Numéro : 6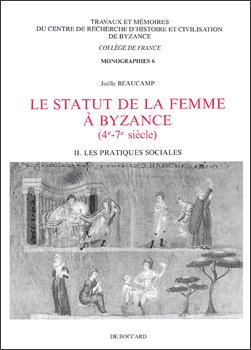
-
Volume de Collection
Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle).
1, Le droit impérial
Numéro : 5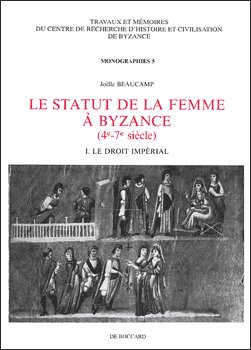
-
Volume de Collection
Inscriptions de Cilicie
Numéro : 4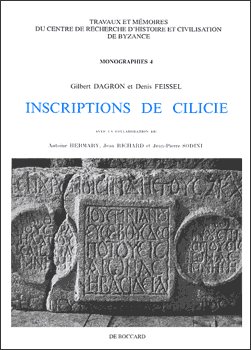
-
Volume de Collection
Paysages de Macédoine
leurs caractères, leur évolution à travers les documents et les récits des voyageurs
Numéro : 3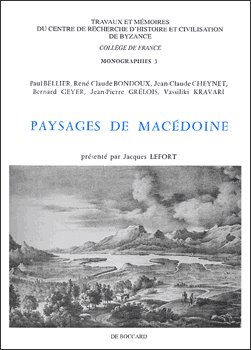
-
Volume de Collection
Le développement urbain de Constantinople
IVe-VIIe siècles
Numéro : 2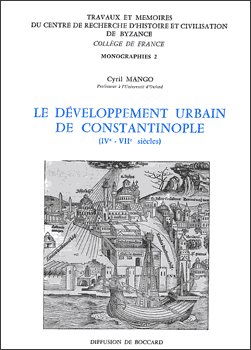
-
Volume de Collection
Villages de Macédoine : notices historiques et topographiques sur la Macédoine orientale au Moyen Âge.
1, La Chalcidique occidentale
Numéro : 1